 Le 20 février dernier, le député indépendant Taito Philip Field a officiellement déposé auprès de la commission électorale néo-zélandaise les statuts d’un nouveau parti baptisé Pacific Party et se réclamant des «valeurs chrétiennes». Né en 1952 à Apia (la capitale de Samoa), T. Ph. Field est une figure historique de l’engagement en politique des Pacific Peoples, ces communautés originaires des îles de Polynésie – principalement Samoa (50%), les îles Cook et Tonga – installées en Nouvelle-Zélande à partir des années 1950 et qui représentent aujourd’hui 6,9% de la population (266,000 personnes). Il a en effet été le premier d’entre eux élu au Parlement en 1993, sous l’étiquette du parti travailliste (Labour Party) et dans la circonscription d’Otara, un des quartiers du Sud-Auckland où se concentrent les Pacific Peoples. Ancien ministre associé des Pacific Islands Affairs, il a régulièrement été réélu depuis, dans la circonscription voisine de Mangere. Il siège aujourd’hui en indépendant après avoir été exclu du Labour Party en février 2007 à la suite de sa mise en examen pour corruption.
Le 20 février dernier, le député indépendant Taito Philip Field a officiellement déposé auprès de la commission électorale néo-zélandaise les statuts d’un nouveau parti baptisé Pacific Party et se réclamant des «valeurs chrétiennes». Né en 1952 à Apia (la capitale de Samoa), T. Ph. Field est une figure historique de l’engagement en politique des Pacific Peoples, ces communautés originaires des îles de Polynésie – principalement Samoa (50%), les îles Cook et Tonga – installées en Nouvelle-Zélande à partir des années 1950 et qui représentent aujourd’hui 6,9% de la population (266,000 personnes). Il a en effet été le premier d’entre eux élu au Parlement en 1993, sous l’étiquette du parti travailliste (Labour Party) et dans la circonscription d’Otara, un des quartiers du Sud-Auckland où se concentrent les Pacific Peoples. Ancien ministre associé des Pacific Islands Affairs, il a régulièrement été réélu depuis, dans la circonscription voisine de Mangere. Il siège aujourd’hui en indépendant après avoir été exclu du Labour Party en février 2007 à la suite de sa mise en examen pour corruption.Les Pacific Peoples ont été à l’origine recrutés en Nouvelle-Zélande sur des contrats de travail temporaires, comme main d’œuvre non qualifiée de l’industrie. Leur situation sociale reste dans l’ensemble modeste, même si on observe une certaine mobilité sociale des jeunes générations vers des emplois de «cols blancs». Dans les années 1970 et à la fin des années 1980, ils ont durement subi les retournements de la conjoncture économique et une politique de libéralisation de l’économie qui a réduit les droits sociaux. Souvent dépendants des aides sociales, ayant aussi gardé en mémoire les positions anti-immigrés de la droite néo-zélandaise à la fin des années 1970, les Pacific Peoples votent massivement pour le Labour Party.
 Ils ont pourtant été heurtés par certaines initiatives législatives récentes du gouvernement d’Helen Clark et de ses alliés, lorsque ceux-ci n’ont pas hésité à prendre à rebrousse-poil les valeurs chrétiennes tradi- tionnelles: légalisation de la prostitution en 2003, union civile (ouverte aux couples homosexuels) en 2004 et en 2007 la loi de pénalisation des châtiments corporels sur les enfants initiée par le Green Party, qualifiée de loi « anti-famille » par plusieurs leaders protestants.
Ils ont pourtant été heurtés par certaines initiatives législatives récentes du gouvernement d’Helen Clark et de ses alliés, lorsque ceux-ci n’ont pas hésité à prendre à rebrousse-poil les valeurs chrétiennes tradi- tionnelles: légalisation de la prostitution en 2003, union civile (ouverte aux couples homosexuels) en 2004 et en 2007 la loi de pénalisation des châtiments corporels sur les enfants initiée par le Green Party, qualifiée de loi « anti-famille » par plusieurs leaders protestants.
 Ils ont pourtant été heurtés par certaines initiatives législatives récentes du gouvernement d’Helen Clark et de ses alliés, lorsque ceux-ci n’ont pas hésité à prendre à rebrousse-poil les valeurs chrétiennes tradi- tionnelles: légalisation de la prostitution en 2003, union civile (ouverte aux couples homosexuels) en 2004 et en 2007 la loi de pénalisation des châtiments corporels sur les enfants initiée par le Green Party, qualifiée de loi « anti-famille » par plusieurs leaders protestants.
Ils ont pourtant été heurtés par certaines initiatives législatives récentes du gouvernement d’Helen Clark et de ses alliés, lorsque ceux-ci n’ont pas hésité à prendre à rebrousse-poil les valeurs chrétiennes tradi- tionnelles: légalisation de la prostitution en 2003, union civile (ouverte aux couples homosexuels) en 2004 et en 2007 la loi de pénalisation des châtiments corporels sur les enfants initiée par le Green Party, qualifiée de loi « anti-famille » par plusieurs leaders protestants.Les Pacific Peoples se distinguent en effet de l’ensemble de la population néo-zélandaise, parmi laquelle une personne sur quatre se déclare aujourd’hui «sans religion» et où la pratique religieuse a sévèrement décliné depuis les années 1970. Le protestantisme pakeha (les Néo-zélandais d’origine européenne) se partage aujourd’hui entre d’un côté des paroisses mainline (anglicanes, presbytériennes et méthodistes) généralement clairsemées et âgées ; et de l’autre la progression des courants évangéliques – au sein même de ces églises ou en dehors, avec notamment le développement de mega-churches urbaines. Les Pacific Peoples au contraire, issus de pays qui ont fait du christianisme (implanté dans ces îles par les missions du 19ème siècle) un élément central de leur identité culturelle, sont massivement présents dans les églises protestantes, au point que celles-ci ont mis en place des structures particulières pour les accueillir (paroisses polynésiennes, instances de représentation nationales). Des églises polynésiennes historiques (Free Wesleyan Church of Tonga, Congregational Christian Church of Samoa, Cook Islands Christian Church) se sont en outre implantées en Nouvelle-Zélande pour accompagner la migration. Les Pacific Peoples constituent donc la grande majorité des pratiquants réguliers et se montrent plus attachés que leurs coreligionnaires pakeha à une définition classique des valeurs chrétiennes.
Sont-ils prêts pour autant à rallier la bannière du Pacific Party? Jusqu’ici, aucun des partis néo-zélandais se réclamant des valeurs chrétiennes n’a réussi à les détourner du vote travailliste. Il faut dire qu’en dépit de nombreuses recompositions et de quelques tentatives d’alliance avec le centre-droit, ces partis restent
 généralement dominés par une droite chrétienne conservatrice dont le programme en matières sociale et économique peut difficilement séduire les Pacific Peoples. À la fin des années 1990, la création de Future New Zealand a marqué les débuts d’une stratégie de déconfession- nalisation visant à convaincre des électeurs au-delà du seul cercle des chrétiens pratiquants, en mettant fin à la Christian Coalition qui associait jusque-là un parti strictement chrétien – le Christian Heritage Party – et un parti plus modéré, le Christian Democrat Party.
généralement dominés par une droite chrétienne conservatrice dont le programme en matières sociale et économique peut difficilement séduire les Pacific Peoples. À la fin des années 1990, la création de Future New Zealand a marqué les débuts d’une stratégie de déconfession- nalisation visant à convaincre des électeurs au-delà du seul cercle des chrétiens pratiquants, en mettant fin à la Christian Coalition qui associait jusque-là un parti strictement chrétien – le Christian Heritage Party – et un parti plus modéré, le Christian Democrat Party.En 2002, un second pas a été franchi avec la fusion entre Future New Zealand et le parti centriste United Future pour former United Future New Zealand, qui a obtenu 6,69% des voix et huit sièges au Parlement – dont quatre pour des militants chrétiens (majoritairement évangéliques). Mais le parti a éclaté en 2007, pour cause de désaccord sur la loi de pénalisation des châtiments corporels ! Retour à la case départ, avec la reformation de Future New Zealand (officiellement rebaptisé Kiwi Party depuis le 15 février 2008) dont un des leaders, Larry Baldock, a lancé une pétition afin d’obtenir un référendum pour la révision de la loi. Tout en refusant d’être réduit à l’étiquette «parti chrétien», le Kiwi Party entend défendre les «valeurs judéo-chrétiennes». Il a été quitté par sa frange la plus conservatrice, qui s’est rapprochée du parti Destiny New Zealand lancé en 2003 par la megachurch pentecôtiste Destiny Church (voir ma note du 11 octobre dernier), pour former le Family Party. Des discussions avancées ont alors eu lieu entre Taito Philip Field et les leaders de ce parti,
 qui ont longtemps cru avoir trouvé en lui le chaînon manquant pour faire se rejoindre le vote pakeha chrétien conservateur et les convictions chrétiennes des Pacific Peoples. C’est peut-être parce qu’il ne croyait pas à cette possibilité que Taito Philip Field a finalement choisi de créer son propre parti, le seul parti chrétien qui soit issu de la gauche de l’échiquier politique.
qui ont longtemps cru avoir trouvé en lui le chaînon manquant pour faire se rejoindre le vote pakeha chrétien conservateur et les convictions chrétiennes des Pacific Peoples. C’est peut-être parce qu’il ne croyait pas à cette possibilité que Taito Philip Field a finalement choisi de créer son propre parti, le seul parti chrétien qui soit issu de la gauche de l’échiquier politique.Les prochaines élections, qui auront lieu fin 2008, permettront donc de savoir dans quelle mesure les convictions chrétiennes des Pacific Peoples peuvent être converties en mobilisation politique ou, pour le dire autrement, si leur opposition latente à la sécularisation de la société néo-zélandaise peut prendre un tour plus militant. Elles préciseront également le poids respectif des différents courants du christianisme politique, puisqu’ils n’auront sans doute jamais été aussi nombreux en lice: un courant très conservateur (Family Party), un courant polynésien (Pacific Party) et entre les deux, le Kiwi Party qui considère les «valeurs judéo-chrétiennes» comme le socle à la fois historique et nécessaire de l’identité néo-zélandaise.
Si aucun d’eux ne peut espérer égaler les deux puissants partis qui structurent la vie politique néo-zélandaise – le parti travailliste et le National Party –, tous rêvent d’être le prochain «kingmaker» : celui qui, dans le système électoral semi-proportionnel de la Nouvelle-Zélande (MMP, Mixed Members Proportional, inspiré du système allemand) a en mains les quelques sièges décisifs dont dépend la formation d’une coalition gouvernementale.
Photos: Taito Philip Field ; culte samoan à la Wesley Church (méthodiste) de Wellington (G. Malogne-Fer) ; parlement néo-zélandais (Y. Fer).
 Dimanche 16 décembre 2007 à 17 heures, l’
Dimanche 16 décembre 2007 à 17 heures, l’ consumérisme n’apporte pas la «paix durable» de la conversion, il y aura quand même eu un peu plus tôt un heureux gagnant dans la salle, lorsque John Cameron invite les spectateurs à regarder sous leur siège à la recherche d’une petite pastille de couleur, pour gagner... un lecteur Mp3 !
consumérisme n’apporte pas la «paix durable» de la conversion, il y aura quand même eu un peu plus tôt un heureux gagnant dans la salle, lorsque John Cameron invite les spectateurs à regarder sous leur siège à la recherche d’une petite pastille de couleur, pour gagner... un lecteur Mp3 ! Elles sont pourtant plusieurs à y rencontrer un certain succès, en adaptant leur mode d’expression (musique et format des cultes), leur discours (style «jeune», prédications souvent plus courtes) et leur organisation (Life groups, réunions et cultes de jeunes). Certaines ont conservé une étiquette dénominationnelle classique, comme la
Elles sont pourtant plusieurs à y rencontrer un certain succès, en adaptant leur mode d’expression (musique et format des cultes), leur discours (style «jeune», prédications souvent plus courtes) et leur organisation (Life groups, réunions et cultes de jeunes). Certaines ont conservé une étiquette dénominationnelle classique, comme la  pêche. Ils n’ont pas encore parlé de religion, mais ça viendra sans doute… on peut difficilement faire plus soft. L’organisation de l’église est elle aussi plus relationnelle qu’institutionnelle. Une logique de désinstitutionalisation liée à l’évolution de la société néo-zélandaise contemporaine? Pas seulement, car The Street n’est pas une église récente créée pour capter l’air du temps : c’est en fait l’une des plus anciennes églises évangéliques de Wellington, issue du mouvement darbyste des Open Brethren (les «frères larges»). Son histoire remonte à 1913, lorsque l’assemblée de Vivian Street décide de se tourner vers les familles déshéritées du centre-ville, une mission qui a donné naissance à une église dix ans plus tard et construit un bâtiment en 1928. Dans les années 1950, elle déménage à Elisabeth Street, au pied du mont Victoria. Son nom officiel est alors the Elisabeth Street Church, mais on la désigne plus couramment par l’abréviation «E Street». En 2002, la croissance de l’église conduit à un nouveau déménagement, sur Hania Street, le E disparaît et l’église ne garde finalement que le nom de «The Street».
pêche. Ils n’ont pas encore parlé de religion, mais ça viendra sans doute… on peut difficilement faire plus soft. L’organisation de l’église est elle aussi plus relationnelle qu’institutionnelle. Une logique de désinstitutionalisation liée à l’évolution de la société néo-zélandaise contemporaine? Pas seulement, car The Street n’est pas une église récente créée pour capter l’air du temps : c’est en fait l’une des plus anciennes églises évangéliques de Wellington, issue du mouvement darbyste des Open Brethren (les «frères larges»). Son histoire remonte à 1913, lorsque l’assemblée de Vivian Street décide de se tourner vers les familles déshéritées du centre-ville, une mission qui a donné naissance à une église dix ans plus tard et construit un bâtiment en 1928. Dans les années 1950, elle déménage à Elisabeth Street, au pied du mont Victoria. Son nom officiel est alors the Elisabeth Street Church, mais on la désigne plus couramment par l’abréviation «E Street». En 2002, la croissance de l’église conduit à un nouveau déménagement, sur Hania Street, le E disparaît et l’église ne garde finalement que le nom de «The Street». Dans la vallée qui conduit vers Johnsonville et Porirua, au nord de Wellington, l’église
Dans la vallée qui conduit vers Johnsonville et Porirua, au nord de Wellington, l’église  Le 10 octobre 2007, le
Le 10 octobre 2007, le  ont connu de nombreuses scissions depuis leur fondation au cours des années 1920. Leur histoire vient d’être retracée par Ian G. Clark, dans un livre paru en 2007, Pentecost at the Ends of the Earth. On y apprend que le pasteur d’origine indienne, Tak Bhana, qui dirige aujourd’hui le WCCC, a été recruté en 1988 suite à une «crise de leadership» ayant entraîné le départ du précédent pasteur. Au cours des dix années suivantes, l’église est devenue l’une des plus dynamiques et des plus grandes assemblées de Dieu de Nouvelle-Zélande. Mais en 1998, elle a finalement quitté les assemblées de Dieu pour devenir une église indépendante.
ont connu de nombreuses scissions depuis leur fondation au cours des années 1920. Leur histoire vient d’être retracée par Ian G. Clark, dans un livre paru en 2007, Pentecost at the Ends of the Earth. On y apprend que le pasteur d’origine indienne, Tak Bhana, qui dirige aujourd’hui le WCCC, a été recruté en 1988 suite à une «crise de leadership» ayant entraîné le départ du précédent pasteur. Au cours des dix années suivantes, l’église est devenue l’une des plus dynamiques et des plus grandes assemblées de Dieu de Nouvelle-Zélande. Mais en 1998, elle a finalement quitté les assemblées de Dieu pour devenir une église indépendante.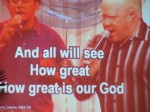 Musique rock, gospel ou groupes culturels, les cultes du WCCC sont un spectacle efficace et professionnel, dont on peut d'ailleurs acheter l’enregis- trement sur DVD. Les prédications du pasteur Bhana cherchent avant tout à être percutantes, comme ce dimanche soir 14 octobre où de 18h à 19h, le culte est axé sur la disparition des «peurs» : en une heure chrono, grâce à la prière et à la lecture de quelques versets-clés, vous allez vous débarrasser de toutes vos peurs, annonce-t-il, avant de conclure la réunion par le traditionnel appel à ceux qui veulent «donner leur cœur à Jésus»…. jusqu’au compte à rebours final, car la réunion se termine à 19h pile. Dans la salle, des Néo-zélandais de toutes origines et de tous âges, y compris des jeunes qui, dans leur ensemble, ont pourtant tendance à déserter les églises.
Musique rock, gospel ou groupes culturels, les cultes du WCCC sont un spectacle efficace et professionnel, dont on peut d'ailleurs acheter l’enregis- trement sur DVD. Les prédications du pasteur Bhana cherchent avant tout à être percutantes, comme ce dimanche soir 14 octobre où de 18h à 19h, le culte est axé sur la disparition des «peurs» : en une heure chrono, grâce à la prière et à la lecture de quelques versets-clés, vous allez vous débarrasser de toutes vos peurs, annonce-t-il, avant de conclure la réunion par le traditionnel appel à ceux qui veulent «donner leur cœur à Jésus»…. jusqu’au compte à rebours final, car la réunion se termine à 19h pile. Dans la salle, des Néo-zélandais de toutes origines et de tous âges, y compris des jeunes qui, dans leur ensemble, ont pourtant tendance à déserter les églises. L’église compte deux auditoriums de plus de mille places, entourés comme il se doit de grands parkings. Elle a ses propres activités missionnaires, en Chine, aux îles Salomon et au Cambodge, où une église a été implantée. Début octobre, une douzaine de jeunes de l’église reviennent justement d’un séjour missionnaire au Cambodge, dont ils présentent un compte rendu en ouverture du culte du 14 octobre.
L’église compte deux auditoriums de plus de mille places, entourés comme il se doit de grands parkings. Elle a ses propres activités missionnaires, en Chine, aux îles Salomon et au Cambodge, où une église a été implantée. Début octobre, une douzaine de jeunes de l’église reviennent justement d’un séjour missionnaire au Cambodge, dont ils présentent un compte rendu en ouverture du culte du 14 octobre.