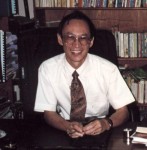 Il y a une semaine, le 14 octobre, le pasteur Louis Levant, ancien président des assemblées de Dieu de Polynésie française et pasteur de l’église d’Orovini à Papeete, quittait Tahiti pour retourner vivre dans son pays d’origine, la Nouvelle-Calédonie. Arrivé en Polynésie française en 1979, il a joué pendant 27 ans un rôle de tout premier plan dans l’émergence et la structuration de cette église, si bien que reprendre les principales étapes de son parcours, c’est aussi revisiter l’histoire du pentecôtisme polynésien. Je n’en reprendrai ici que quelques-unes.
Il y a une semaine, le 14 octobre, le pasteur Louis Levant, ancien président des assemblées de Dieu de Polynésie française et pasteur de l’église d’Orovini à Papeete, quittait Tahiti pour retourner vivre dans son pays d’origine, la Nouvelle-Calédonie. Arrivé en Polynésie française en 1979, il a joué pendant 27 ans un rôle de tout premier plan dans l’émergence et la structuration de cette église, si bien que reprendre les principales étapes de son parcours, c’est aussi revisiter l’histoire du pentecôtisme polynésien. Je n’en reprendrai ici que quelques-unes.Vietnamien du pays minier néo-calédonien
Né de parents vietnamiens, venus de l’Indochine française pour travailler dans les mines de nicklel, de chrome et de manganèse en Nouvelle-Calédonie, Louis Levant a grandi dans une famille de 14 enfants, installée à 400 kilomètres au nord de Nouméa. Comme ses parents, il fréquente alors l’église catholique. « La préoccupation première de mes parents, c’était de survivre », me disait-il lors d’un entretien en janvier 2001. « Mes parents travaillaient dans les mines, ils avaient un numéro, c’était peut-être plus facile pour le contremaître. Ils ont travaillé sur les mines de nickel, ils ont acheté un petit bouiboui et avec les économies après, ça s’est agrandi, le petit bouiboui est devenu un magasin ».
Mobilité individuelle et conversion
En 1970, Louis Levant part à Montpellier pour suivre des études de droit. « À cette époque, dit-il, je croyais en Dieu, c’est vrai, mais ma seule préoccupation, c’était de finir mes études, je voulais faire haute administration ou barreau, avec un ami mélanésien. » C’est là qu’il se convertit au pentecôtisme, des circonstances que l’on retrouve très fréquemment dans les itinéraires pentecôtistes : une mobilité sociale et géographique qui éloigne du milieu familial et renforce la conviction qu’il faut par soi-même trouver le moyen de « faire sa vie » ; la rencontre avec des jeunes qui vivent le christianisme non comme un héritage obligé mais un engagement personnel. À la même époque, l’organisation Youth With a Mission (Jeunesse en Mission) recrute, dans le quartier polynésien de Ponsonby à Auckland, de futurs « équipiers » parmi la jeune génération polynésienne née en Nouvelle-Zélande ou venue y étudier. Exode rural, migrations internationales, mobilité sociale : le pentecôtisme est d’abord une religion de la mobilité.
A Montpellier, Louis Levant rencontre des étudiants pentecôtistes qui distribuent des bibles au restaurant universitaire. Il accepte leur invitation pour des réunions de jeunesse et de prière où l’on parle de guérisons, de vies transformées puis rejoint une petite église pentecôtiste de la région.
Missions pentecôtistes dans le Pacifique francophone et protestantisme chinois
L’action missionnaire des assemblées de Dieu françaises, qui s’organise à partir de 1955 (les assemblées elles-mêmes sont créées en 1932) se concentre sur les colonies françaises, qui accèdent à l’indépendance au cours des années 1960, et sur les DOM-TOM : Gabon, Haute-Volta, Côte d’Ivoire, ancienne Indochine, la Réunion. Elle est présente dès 1955 en Nouvelle-Calédonie. Mais son implantation en Polynésie française est beaucoup plus tardive et emprunte des chemins détournés (cf. article « Une histoire hakka ») : c’est d’abord au sein de la communauté chinoise de Tahiti, sous l’impulsion d’un évangéliste sino-américain, que le pentecôtisme y apparaît en 1967.
En 1979, lorsque Louis Levant, devenu pasteur des assemblées, est appelé en Polynésie française pour seconder Roger Albert, il rejoint donc une église chinoise, l’église Alléluia dont Roger Albert est le pasteur depuis 1975. Son arrivée est liée à une crise survenue entre missionnaires français, sur une question essentielle et qui déterminera toute l’histoire du pentecôtisme polynésien : faut-il créer des églises communautaires, regroupant séparément les Chinois, les Polynésiens, les Popa’a (Européens, blancs) ou une seule église transculturelle ?
Pasteur Levant sur RTV
Sous la présidence de Louis Levant, les assemblées de Dieu ont créé plusieurs associations de jeunesse, installé des équipes d’aumônerie à l’hôpital et à la prison. Mais aucune de ces initiatives n’a eu un impact comparable à celui de la station de radio ouverte en 1997, te vevo o te tiaturira’a (RTV, la « radio de l’espoir »), première radio chrétienne en Polynésie française (1). En 2000, un sondage Louis Harris estimait à plus de 30000 le nombre de personnes qui connaissent RTV dans les îles Sous-le-Vent et entre 4400 et 7700 le nombre de ses auditeurs tout au long de la semaine.
Parfois surnommé « pasteur gadget » par les fidèles, pour son goût immodéré des innovations technologiques, Louis Levant s’est beaucoup investi dans cette entreprise qui lui a ouvert les portes de beaucoup de foyers polynésiens, bien au-delà des murs de son église : dans leur voiture, au bureau, à la maison, des Polynésiens protestants, adventistes ou catholiques écoutent « Levant, le matin sur RTV ». Jusque dans les bureaux de l’église protestante ma’ohi, on entend RTV, qui ne se présente jamais comme la radio des assemblées (ce qu’elle est, objectivement) mais comme une radio « chrétienne ».
Or, ce type de média entretient des affinités évidentes avec les attentes contemporaines vis-à-vis de la religion : une expérience personnelle, quelque chose de « spirituel mais pas religieux » que l’on peut construire en partie par soi-même en dehors de l’autorité institutionnelle, en lisant les livres des évangéliques nord-américains, en écoutant la radio ou en assistant aux concerts organisés par RTV – le québécois Luc Dumont, Exo.
A suivre…
En 2004, le pasteur Éric Barber a succédé à Louis Levant à la présidence des assemblées. De mère polynésienne, c’est avant tout un évangéliste, à l’initiative des missions lancées depuis 2000 aux îles Marquises, tandis que Louis Levant serait plutôt un « pasteur-berger », davantage tourné vers l’accompagnement des membres de l’église que vers la conquête de nouveaux membres. Louis Levant a choisi de suivre des formations à l’église Nouvelle Vie de Longueuil, une méga-église de la banlieue de Montréal avec laquelle il entretient depuis plusieurs années des relations suivies et qui est aussi un des pôles majeurs d’innovation au sein du pentecôtisme francophone. Un pôle qui contrebalance notamment l’orientation très conservatrice des assemblées de Dieu françaises et diffuse en particulier les méthodes du counseling ou psychologie chrétienne – un secteur qui connaît au sein du protestantisme évangélique un engouement considérable.
Louis Levant a rejoint les assemblées néo-calédoniennes, historiquement proches des assemblées françaises du nord de la France (plus conservatrices qu’au Sud), afin de participer à la formation des pasteurs et à la mise en place d’un réseau pentecôtiste francophone dans le Pacifique. Une raison supplémentaire pour entreprendre l’étude sociologique du pentecôtisme et plus largement du protestantisme évangélique néo-calédonien qui, comme je le soulignais dans une note en juillet dernier, reste à faire.

 Au début des années 1980, dans le sillage des différents mouvements de «sportifs chrétiens» qui voient alors le jour en terrain protestant évangélique nord-américain, de jeunes surfeurs australiens créent la première association de Surfeurs Chrétiens, destinée à évangéliser les milieux du surf, a priori bien éloignés des valeurs de modération et de la mise en ordre des vies personnelles prônées par le protestantisme évangélique. Mais les jeunes évangéliques, surtout ceux qui sont «nés dans l’église», ont aussi envie de se distinguer du rigorisme parental et de la société environnante trop «tièdes» en affirmant une identité chrétienne, radicale, moderne et sportive. C’est porté par cet effet de génération, puis par l’effet d’imitation lié à la médiatisation de plusieurs champions internationaux «chrétiens», que le mouvement, devenu Christian Surfers International (CSI) s’est implanté dès 1985 en Nouvelle-Zélande, puis aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne (au cours des années 1990), en Europe et au Japon. En 2001, le mouvement brésilien surfitas de Christo s’est affilié à CSI, suivi par d’autres associations sud-américaines. L’organisation évangélique charismatique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, l’une des plus importantes organisations missionnaires actuelles) a elle aussi fondé un «ministère» axé sur le surf, Surfers for Missions International (SFMI), qui collabore avec CSI au sein du réseau mondial Surf Ministries International fondé en 1993.
Au début des années 1980, dans le sillage des différents mouvements de «sportifs chrétiens» qui voient alors le jour en terrain protestant évangélique nord-américain, de jeunes surfeurs australiens créent la première association de Surfeurs Chrétiens, destinée à évangéliser les milieux du surf, a priori bien éloignés des valeurs de modération et de la mise en ordre des vies personnelles prônées par le protestantisme évangélique. Mais les jeunes évangéliques, surtout ceux qui sont «nés dans l’église», ont aussi envie de se distinguer du rigorisme parental et de la société environnante trop «tièdes» en affirmant une identité chrétienne, radicale, moderne et sportive. C’est porté par cet effet de génération, puis par l’effet d’imitation lié à la médiatisation de plusieurs champions internationaux «chrétiens», que le mouvement, devenu Christian Surfers International (CSI) s’est implanté dès 1985 en Nouvelle-Zélande, puis aux Etats-Unis, en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne (au cours des années 1990), en Europe et au Japon. En 2001, le mouvement brésilien surfitas de Christo s’est affilié à CSI, suivi par d’autres associations sud-américaines. L’organisation évangélique charismatique Jeunesse en Mission (Youth With a Mission, l’une des plus importantes organisations missionnaires actuelles) a elle aussi fondé un «ministère» axé sur le surf, Surfers for Missions International (SFMI), qui collabore avec CSI au sein du réseau mondial Surf Ministries International fondé en 1993. Selon
Selon  En outre, CSI a développé une série d’activités destinées plus spécifiquement aux églises locales, selon une logique d’agence de moyens que l’on retrouve désormais de plus en plus en milieu protestant évangélique : ministères pour la famille, les jeunes, les médias, séminaires de formation, etc. Cette dynamique qui fonctionne en réseaux internationaux ouvre à chaque église des possibilités bien plus larges que ce qu’elle aurait pu mettre en œuvre dans le seul cadre de la congrégation locale.
En outre, CSI a développé une série d’activités destinées plus spécifiquement aux églises locales, selon une logique d’agence de moyens que l’on retrouve désormais de plus en plus en milieu protestant évangélique : ministères pour la famille, les jeunes, les médias, séminaires de formation, etc. Cette dynamique qui fonctionne en réseaux internationaux ouvre à chaque église des possibilités bien plus larges que ce qu’elle aurait pu mettre en œuvre dans le seul cadre de la congrégation locale.