 Des extraits du livre que j'ai publié en 2005 sur le pentecôtisme en Polynésie française sont désormais disponibles sur Google Books. Un bon nombre de pages passent ainsi en libre accès, pour tous ceux qui souhaitent y jeter un oeil, y faire des recherches par mots-clés ou avoir un aperçu assez complet du livre avant de le commander. Il suffit de cliquer ici. Bonne lecture !
Des extraits du livre que j'ai publié en 2005 sur le pentecôtisme en Polynésie française sont désormais disponibles sur Google Books. Un bon nombre de pages passent ainsi en libre accès, pour tous ceux qui souhaitent y jeter un oeil, y faire des recherches par mots-clés ou avoir un aperçu assez complet du livre avant de le commander. Il suffit de cliquer ici. Bonne lecture !
Yannick Fer - Page 21
-
Pentecôtisme en Polynésie française sur Google Books
-
Israel Kamakawiwo'ole, "la voix du peuple hawaiien"

 Je vous propose un petit détour par la musique hawaiienne pour finir l'année 2008 en douceur. Né en 1959 sur l'île d'Oahu à Hawaii, l'année où cet archipel devenait le 50ème Etat des Etats-Unis d'Amérique, Israel Ka'ano'i Kamakawiwo'ole - surnommé Iz ou "Bruddah Iz" - est encore aujourd'hui, plus de dix ans après sa mort, la plus éminente figure de la chanson hawaiienne contemporaine et l'un des symboles de la lutte du peuple hawaiien pour défendre sa culture et son droit à l'indépendance. Sa mort en 1997, à la suite de difficultés respiratoires liées à une obésité maladive (il avait dépassé les 300 kilos, pour une taille d' 1m90) a donné lieu à des funérailles quasi-nationales, au cours desquelles ses cendres ont été dispersées au-dessus de l'Océan Pacifique. Dans une biographie officielle publiée en 2006 par Rick Carroll (Iz, Voice of the People), ce dernier écrit que la vie de Iz "a été à l'image de la vie dans les îles d'Hawaii durant les quarante premières années de son histoire en tant qu'Etat américain":
Je vous propose un petit détour par la musique hawaiienne pour finir l'année 2008 en douceur. Né en 1959 sur l'île d'Oahu à Hawaii, l'année où cet archipel devenait le 50ème Etat des Etats-Unis d'Amérique, Israel Ka'ano'i Kamakawiwo'ole - surnommé Iz ou "Bruddah Iz" - est encore aujourd'hui, plus de dix ans après sa mort, la plus éminente figure de la chanson hawaiienne contemporaine et l'un des symboles de la lutte du peuple hawaiien pour défendre sa culture et son droit à l'indépendance. Sa mort en 1997, à la suite de difficultés respiratoires liées à une obésité maladive (il avait dépassé les 300 kilos, pour une taille d' 1m90) a donné lieu à des funérailles quasi-nationales, au cours desquelles ses cendres ont été dispersées au-dessus de l'Océan Pacifique. Dans une biographie officielle publiée en 2006 par Rick Carroll (Iz, Voice of the People), ce dernier écrit que la vie de Iz "a été à l'image de la vie dans les îles d'Hawaii durant les quarante premières années de son histoire en tant qu'Etat américain":"Comme toute une génération de Hawaiiens, Israël est né dans une version américaine de la Polynésie, dans une culture inventée faite pour attirer les touristes. Il a atteint l'âge adulte alors que d'autres Hawaiiens, plus âgés, cherchaient à faire revivre leur culture moribonde et à obtenir la souveraineté et la dignité en tant que peuple autochtone (native people)."
En 1993, son deuxième album Facing Future a atteint les sommets des hit-parades hawaiiens et américains, et fait de lui une star, avec notamment sa chanson la plus connue, "Somewhere over the rainbow/what a wonderful world", dont voici une vidéo:
 Né à Honolulu, capitale hawaiienne et épicentre de l'industrie touristique avec Waikiki Beach, Iz a grandi au pied de la célèbre colline du Diamond Head (que l'on aperçoit à l'arrière-plan de toutes les photos de la plage de Waikiki), à Palolo Valley. Son grand-père maternel, dont il était très proche, était originaire de Ni'ihau, une petite île où il l'emmenait pendant les vacances d'été et où ne vivent pratiquement que des Native Hawaiians: surnommée "l'île interdite", elle est la propriété des familles Gay et Robinson, qui y exploitent un ranch et se sont efforcées d'y préserver par un relatif isolement la vie traditionnelle et la culture hawaiiennes. La musique y occupe une place importante et Iz a très tôt été familiarisé avec cette ambiance musicale hawaiienne. A la maison, tout le monde chante, au rythme du 'ukulele et de la guitare: "Le père et la mère d'Israel chantaient à l'église, à la maison, et pendant les fêtes organisées dans le jardin chaque fois que leurs amis s'y retrouvaient, c'est-à-dire souvent", écrit R. Carroll.
Né à Honolulu, capitale hawaiienne et épicentre de l'industrie touristique avec Waikiki Beach, Iz a grandi au pied de la célèbre colline du Diamond Head (que l'on aperçoit à l'arrière-plan de toutes les photos de la plage de Waikiki), à Palolo Valley. Son grand-père maternel, dont il était très proche, était originaire de Ni'ihau, une petite île où il l'emmenait pendant les vacances d'été et où ne vivent pratiquement que des Native Hawaiians: surnommée "l'île interdite", elle est la propriété des familles Gay et Robinson, qui y exploitent un ranch et se sont efforcées d'y préserver par un relatif isolement la vie traditionnelle et la culture hawaiiennes. La musique y occupe une place importante et Iz a très tôt été familiarisé avec cette ambiance musicale hawaiienne. A la maison, tout le monde chante, au rythme du 'ukulele et de la guitare: "Le père et la mère d'Israel chantaient à l'église, à la maison, et pendant les fêtes organisées dans le jardin chaque fois que leurs amis s'y retrouvaient, c'est-à-dire souvent", écrit R. Carroll.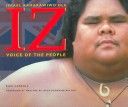 Lorsqu'il a 14 ans, sa famille part à Makaha, un village hawaiien relativement isolé et pauvre, sur la côte de Wai'anae (à l'ouest d'Oahu), qui est aussi fréquentée par les surfeurs chevronnés, attirés par des vagues de près de neuf mètres. C'est là qu'il forme, avec son frère Skippy, son premier groupe de musique, les Makaha Sons of Ni'ihau, qui publiera dix albums entre 1976 et 1991. Il débutera parallèlement une carrière solo en 1989. Selon son biographe, c'est aussi à Makaha qu'il s'approprie plus profondément encore les valeurs culturelles, tout en fréquentant l'église pentecôtiste dont son grand-père paternel est pasteur. Car Iz a été à la fois un fervent défenseur de la culture hawaiienne et un chrétien "born again" ("né de nouveau", c'est-à-dire évangélique), comme il se définissait lui-même lors d'un concert filmé quelques mois avant sa mort.
Lorsqu'il a 14 ans, sa famille part à Makaha, un village hawaiien relativement isolé et pauvre, sur la côte de Wai'anae (à l'ouest d'Oahu), qui est aussi fréquentée par les surfeurs chevronnés, attirés par des vagues de près de neuf mètres. C'est là qu'il forme, avec son frère Skippy, son premier groupe de musique, les Makaha Sons of Ni'ihau, qui publiera dix albums entre 1976 et 1991. Il débutera parallèlement une carrière solo en 1989. Selon son biographe, c'est aussi à Makaha qu'il s'approprie plus profondément encore les valeurs culturelles, tout en fréquentant l'église pentecôtiste dont son grand-père paternel est pasteur. Car Iz a été à la fois un fervent défenseur de la culture hawaiienne et un chrétien "born again" ("né de nouveau", c'est-à-dire évangélique), comme il se définissait lui-même lors d'un concert filmé quelques mois avant sa mort.Une vidéo intéressante (et que vous trouverez ci-dessous), où il exhorte les Hawaiiens à se mobiliser pour sauver la jeunesse de la délinquance et du chômage, défendre la culture et les droits politiques hawaiiens, en même temps qu'il évoque sa foi évangélique. Une association qui à Hawaii ne va pas de soi: comme dans beaucoup d'îles du Pacifique, les relations entre culture et christianisme ont d'abord été marquées par l'hostilité des missionnaires puritains vis-à-vis de la culture locale et plus particulièrement la hula, danse hawaiienne considérée par
 eux comme trop sensuelle. Dans la foulée de la renaissance culturelle des années 1970, dont l'un des symboles a été justement la hula, cette danse a pourtant fait un retour aussi controversé que spectaculaire dans certaines églises chrétiennes, désormais devenues les porte-parole de l'identité culturelle hawaiienne. Dans une thèse d'anthropologie soutenue en 2003 à l'université d'Hawaii, Akihiro Inoue a consacré un chapitre passionnant à cette histoire. Il explique notamment comment les églises de la Hawaii Conference United Church of Christ (l'église protestante historique, issue au 19ème siècle des missions puritaines américaines) ont inventé une troisième sorte de hula, après la hula kahiko ou ancienne hula - accompagnée de tambours traditionnels et tournée vers l’adoration des divinités locales et de la nature - , la hula ‘auana ou hula moderne - dominée par les mouvements de hanches des vahine hawaiiennes et destinée à l'origine aux touristes: c'est la hula chrétienne, ou "hula de mains", composée uniquement de mouvements des mains, accompagnés de paroles inspirées de la Bible.
eux comme trop sensuelle. Dans la foulée de la renaissance culturelle des années 1970, dont l'un des symboles a été justement la hula, cette danse a pourtant fait un retour aussi controversé que spectaculaire dans certaines églises chrétiennes, désormais devenues les porte-parole de l'identité culturelle hawaiienne. Dans une thèse d'anthropologie soutenue en 2003 à l'université d'Hawaii, Akihiro Inoue a consacré un chapitre passionnant à cette histoire. Il explique notamment comment les églises de la Hawaii Conference United Church of Christ (l'église protestante historique, issue au 19ème siècle des missions puritaines américaines) ont inventé une troisième sorte de hula, après la hula kahiko ou ancienne hula - accompagnée de tambours traditionnels et tournée vers l’adoration des divinités locales et de la nature - , la hula ‘auana ou hula moderne - dominée par les mouvements de hanches des vahine hawaiiennes et destinée à l'origine aux touristes: c'est la hula chrétienne, ou "hula de mains", composée uniquement de mouvements des mains, accompagnés de paroles inspirées de la Bible.Les églises pentecôtistes, présentes à Hawaii dès le début du 20ème siècle, ont été dans leur ensemble plutôt hostiles ou indifférentes à cette renaissance culturelle et, par exemple, n'ont pas accepté la hula comme expression légitime de la foi chrétienne. Mais à Hawaii comme ailleurs, le pentecôtisme est aussi très divers. Il n'est donc pas impossible que l'église du grand-père de Iz, fréquentée sans doute exclusivement par des autochtones hawaiiens et peut-être implantée de longue date dans ce village, ait autorisé une association plus étroite entre culture hawaiienne et pentecôtisme. Aujourd'hui, les mouvements évangéliques qui mettent le plus volontiers en scène la culture hawaiienne (souvent sous des formes assez stéréotypées) sont surtout les églises de la "troisième vague" pentecôtiste, comme la King's Cathedral (ancienne Fisrt Assembly of God de
 Maui), et les milieux charismatiques proches de l'organisation missionnaire Youth With a Mission au travers de sa branche Island Breeze (ci-contre), née en 1979 entre les îles Samoa et Hawaii dans le but d'utiliser les danses océaniennes comme moyen d'expression du credo évangélique et outil d'action missionnaire.
Maui), et les milieux charismatiques proches de l'organisation missionnaire Youth With a Mission au travers de sa branche Island Breeze (ci-contre), née en 1979 entre les îles Samoa et Hawaii dans le but d'utiliser les danses océaniennes comme moyen d'expression du credo évangélique et outil d'action missionnaire.Voici la vidéo où Iz exprime à la fois son engagement pour la culture hawaiienne et son identité de chrétien "born again", en préambule à une chanson en hawaiien:
-
Nouvelle-Zélande: victoire de la droite, échec des partis chrétiens




Dans une note de mars dernier, je vous parlais de la création du New Zealand Pacific Party, un parti polynésien se réclamant des valeurs chrétiennes fondé par un ancien député travailliste d'origine samoane, Taito Philip Field. À ses côtés, deux autres partis chrétiens étaient lancés dans la bataille en vue des élections générales:
- Le Family Party, un parti très conservateur qui comprend notamment les anciens membres du parti Destiny New Zealand lancé en 2003 par la megachurch pentecôtiste Destiny Church (voir ma note du 11 octobre 2007).
- Le Kiwi Party, où l'on retrouve de nombreux missionnaires de l'organisation évangélique Youth With a Mission (YWAM), dont les anciens députés Larry Baldock (ancien directeur national de YWAM aux Philippines) et Bernie Ogilvy (ancien directeur national en Nouvelle-Zélande). Le président du parti, Franck Naea, est lui-même un ancien président international de YWAM.
 Il restait à savoir quel écho ces trois partis trouveraient auprès des électeurs néo-zélandais et, plus particulièrement, combien d'électeurs polynésiens - regroupés essentiellement dans quelques circonscriptions des agglomérations d'Auckland et de Wellington - feraient passer leurs convictions religieuses avant des considérations politiques plus générales, les incitant plutôt à rester fidèles au Labour Party. Samedi dernier, les urnes ont livré leur verdict.
Il restait à savoir quel écho ces trois partis trouveraient auprès des électeurs néo-zélandais et, plus particulièrement, combien d'électeurs polynésiens - regroupés essentiellement dans quelques circonscriptions des agglomérations d'Auckland et de Wellington - feraient passer leurs convictions religieuses avant des considérations politiques plus générales, les incitant plutôt à rester fidèles au Labour Party. Samedi dernier, les urnes ont livré leur verdict.Elles ont d'abord confirmé ce que les sondages annonçaient depuis plusieurs mois: après trois mandats successifs (depuis 1999), Helen Clark doit céder la place au National Party, un parti de centre-droit mené par John Key (deuxième photo en partant de la gauche), nouveau premier ministre, qui disposera au Parlement d'une majorité très confortable, renforcée par le soutien du parti conservateur Act New Zealand de Rodney Hide (photo de droite), du parti centriste United Future New Zealand et du Maori Party. Avec 6% et 8 élus, le Green Party (écologiste) de Jeanette Fitzsimons gagne un peu de terrain (1 point de plus qu'en 2005 et deux sièges suplémentaires), mais moins que prévu. Enfin, le Parlement comptera désormais 5 élus d'origine océanienne, ce qui est relativement peu mais constitue malgré tout un record. Quant aux partis chrétiens, ils ont tous perdu leur pari.
Echec du New Zealand Pacific Party: pas de vote chrétien chez les Pacific Peoples
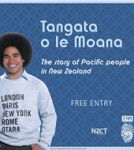 Pour le parti de Taito Philip Field, l'équation était a priori assez simple: les Pacific Peoples, Polynésiens vivant en Nouvelle-Zélande, sont aujourd'hui 266,000 (6,9% de la population). Ils sont très attachés au christianisme, beaucoup plus pratiquants que l'ensemble de la population néo-zélandaise et ont été parfois heurtés dans leurs convictions chrétiennes par des lois votées au cours des dernières années par le gouvernement travailliste: légalisation de la prostitution, union civile ouverte aux homosexuels et plus récemment, la loi réprimant les punitions corporelles sur les enfants - dénoncée par des réseaux chrétiens militants comme "anti-famille". Mais convictions religieuses et vote chrétien restent deux choses distinctes et le New Zealand Pacific Party n'est pas parvenu à opérer la conversion des premières au second.
Pour le parti de Taito Philip Field, l'équation était a priori assez simple: les Pacific Peoples, Polynésiens vivant en Nouvelle-Zélande, sont aujourd'hui 266,000 (6,9% de la population). Ils sont très attachés au christianisme, beaucoup plus pratiquants que l'ensemble de la population néo-zélandaise et ont été parfois heurtés dans leurs convictions chrétiennes par des lois votées au cours des dernières années par le gouvernement travailliste: légalisation de la prostitution, union civile ouverte aux homosexuels et plus récemment, la loi réprimant les punitions corporelles sur les enfants - dénoncée par des réseaux chrétiens militants comme "anti-famille". Mais convictions religieuses et vote chrétien restent deux choses distinctes et le New Zealand Pacific Party n'est pas parvenu à opérer la conversion des premières au second.Dans la circonscription de Mangere, un quartier polynésien au sud d'Auckland dont il était le député sortant, T.P. Field a recueilli seulement 22% des voix sur son nom et 10% en "party vote" (le Parlement néo-zélandais est élu à la proportionnelle et chaque électeur choisit un candidat et un parti). Il est loin derrière le candidat du Labour, Su'a William Sio, qui remporte le siège avec 52% des voix. Il faut dire que S. W. Sio est lui aussi Samoan, lui aussi titulaire d'un titre traditionnel samoan de matai (chef de famille) et lui aussi chrétien fervent. Lors de son entrée au Parlement, en avril 2008, il débutait son discours inaugural
 (maiden speech) en expliquant comment, avant de rejoindre le Parlement, il avait tenu à se rendre à Samoa pour recevoir la bénédiction des anciens de son village et des diacres de l'église protestante - hiérarchie familiale et hiérarchie ecclésiale étant étroitement liées dans le système villageois traditionnel de Samoa.
(maiden speech) en expliquant comment, avant de rejoindre le Parlement, il avait tenu à se rendre à Samoa pour recevoir la bénédiction des anciens de son village et des diacres de l'église protestante - hiérarchie familiale et hiérarchie ecclésiale étant étroitement liées dans le système villageois traditionnel de Samoa.Autrement dit, entre deux Samoans chrétiens, les électeurs polynésiens ont choisi celui qui représentait de surcroît le parti ayant toujours accordé une attention particulière aux Pacific Peoples. Il y aura probablement dans les années à venir de plus en plus de mobilisations pour la défense des "valeurs chrétiennes" parmi les Polynésiens de Nouvelle-Zélande, mais l'échec électoral du New Zealand Pacific Party semble indiquer que ces mobilisations ne s'appuieront pas sur un parti politique, mais tout simplement sur les réseaux d'églises. Entre autres, parce qu'elles ne sont pas vécues comme des revendications politiques, mais sur le registre du droit à la différence culturelle, le christianisme se trouvant incorporé à une définition de l'identité distinctive des Pacific Peoples, dans le cadre d'une société multiculturelle.
Kiwi Party: les "smackers" n'étaient pas au rendez-vous
 Le Kiwi Party avait démontré ces derniers mois ses capacités de mobilisation, en déposant en août 2008 une pétition signée par 310,000 Néo-zélandais en faveur d'un référendum sur la révision de la loi sur les châtiments corporels, baptisée "anti-smacking" (anti-fessée) par ses opposants. Comme le notait le New Zealand Herald dans un article du 25 octobre dernier, cette loi reste un "hot topic", un sujet brûlant qui selon les sondages passionne - et divise - au-delà des seuls réseaux militants et a refait surface au cours de la pré-campagne électorale. Pourtant, après 18 mois d'application de la loi, seuls 8 parents ont été poursuivis, ce qui a fait dire à John Key que cette loi était correctement utilisée. Les leaders du Kiwi Party, qui ont beaucoup joué sur le registre populiste du bon sens citoyen contre les politiciens forcément loin des réalités du terrain espéraient sans doute retrouver une bonne partie des pétitionnaires parmi leurs électeurs. Mais ils n'ont obtenu dans tout le pays que... 11,659 voix. À Tauranga, une ville de l'île du Nord où il a été élu local, Larry Baldock ne dépasse pas 2%. Encore une fois, un constat s'impose: les réseaux chrétiens sont capables de mobiliser des dizaines de milliers de personnes sur une cause particulière illustrant la défense des "valeurs familiales", mais lorsqu'il s'agit d'élections ces questions ne remplacent pas un programme politique plus élaboré, couvrant tous les aspects de la vie sociale et économique du pays.
Le Kiwi Party avait démontré ces derniers mois ses capacités de mobilisation, en déposant en août 2008 une pétition signée par 310,000 Néo-zélandais en faveur d'un référendum sur la révision de la loi sur les châtiments corporels, baptisée "anti-smacking" (anti-fessée) par ses opposants. Comme le notait le New Zealand Herald dans un article du 25 octobre dernier, cette loi reste un "hot topic", un sujet brûlant qui selon les sondages passionne - et divise - au-delà des seuls réseaux militants et a refait surface au cours de la pré-campagne électorale. Pourtant, après 18 mois d'application de la loi, seuls 8 parents ont été poursuivis, ce qui a fait dire à John Key que cette loi était correctement utilisée. Les leaders du Kiwi Party, qui ont beaucoup joué sur le registre populiste du bon sens citoyen contre les politiciens forcément loin des réalités du terrain espéraient sans doute retrouver une bonne partie des pétitionnaires parmi leurs électeurs. Mais ils n'ont obtenu dans tout le pays que... 11,659 voix. À Tauranga, une ville de l'île du Nord où il a été élu local, Larry Baldock ne dépasse pas 2%. Encore une fois, un constat s'impose: les réseaux chrétiens sont capables de mobiliser des dizaines de milliers de personnes sur une cause particulière illustrant la défense des "valeurs familiales", mais lorsqu'il s'agit d'élections ces questions ne remplacent pas un programme politique plus élaboré, couvrant tous les aspects de la vie sociale et économique du pays.Family Party: des chrétiens minoritaires mais très militants
Enfin, avec seulement 0,33%, le Family Party ne récolte pas plus de suffrages que son prédécesseur - le Destiny Party - lors des précédents scrutins. Cette minorité chrétienne conservatrice, dont le noyau dur est essentiellement constitué par les fidèles de l'église Destiny Church, rencontre davantage de succès sur le terrain religieux - avec son credo de "remise en ordre" des vies personnelles - que sur celui de la politique.
Illustrations (de haut en bas): de gauche à droite, Helen Clark, John Key, Jeanette Fitzsimons et Rodney Hide ; "Tangata o te moana" (Pacific Peoples), affiche d'une exposition du musée national Te Papa (Wellington) ; Sua William Sio ; manifestation anti-smacking.