 Dans son édition des 30-31 octobre, Le Monde revient sur la question de la pénalisation des châtiments corporels sur les enfants – que l’on traduit généralement en termes plus expéditifs : faut-il une loi pour interdire la fessée ? A l’occasion de son colloque annuel qui s’est tenu le 20 octobre dernier, la fédération française de psychothérapie et psychanalyse (FF2P) a en effet adopté une motion réclamant une loi pour "abolir la violence physique et psychologique envers les enfants". D’autres psychologues ou pédiatres plus conservateurs, défenseurs de l’autorité patriarcale et de l’ordre "naturel", comme Aldo Naouri, s’y opposent.
Dans son édition des 30-31 octobre, Le Monde revient sur la question de la pénalisation des châtiments corporels sur les enfants – que l’on traduit généralement en termes plus expéditifs : faut-il une loi pour interdire la fessée ? A l’occasion de son colloque annuel qui s’est tenu le 20 octobre dernier, la fédération française de psychothérapie et psychanalyse (FF2P) a en effet adopté une motion réclamant une loi pour "abolir la violence physique et psychologique envers les enfants". D’autres psychologues ou pédiatres plus conservateurs, défenseurs de l’autorité patriarcale et de l’ordre "naturel", comme Aldo Naouri, s’y opposent.
La Suède, rappelle l’article, a été le premier pays à adopter une loi bannissant la fessée, dès 1979, et 29 pays ont suivi le même chemin, en Europe mais aussi au Kenya, au Venezuela, en Ukraine ou au Soudan du Sud, tout nouvel Etat africain à forte majorité chrétienne (comme le soulignait le mois dernier mon  collègue Sébastien Fath). La Nouvelle-Zélande fait elle aussi partie de ces 29 pays. L’adoption d’une loi contre les châtiments corporels en mai 2007, à l’initiative des écologistes du Green Party, y a suscité un large débat public et une campagne d’opinion menée par des leaders de la droite chrétienne (en particulier Larry Baldock, ancien responsable de Youth With a Mission dont j’ai déjà parlé ici) a conduit en 2009 à l’organisation d’un référendum consultatif. Les électeurs néo-zélandais étaient appelés à répondre à la question suivante :"Est-ce qu’en Nouvelle-Zélande, une gifle donnée dans le cadre d’une bonne éducation parentale doit être considérée comme un délit ?"
collègue Sébastien Fath). La Nouvelle-Zélande fait elle aussi partie de ces 29 pays. L’adoption d’une loi contre les châtiments corporels en mai 2007, à l’initiative des écologistes du Green Party, y a suscité un large débat public et une campagne d’opinion menée par des leaders de la droite chrétienne (en particulier Larry Baldock, ancien responsable de Youth With a Mission dont j’ai déjà parlé ici) a conduit en 2009 à l’organisation d’un référendum consultatif. Les électeurs néo-zélandais étaient appelés à répondre à la question suivante :"Est-ce qu’en Nouvelle-Zélande, une gifle donnée dans le cadre d’une bonne éducation parentale doit être considérée comme un délit ?"
 Ceux qui se sont déplacés pour voter – un peu plus d’un électeur sur deux – ont massivement répondu "non" (à 87%). Il faut dire que la question était assez clairement orientée... Le premier ministre conservateur John Key (élu en novembre 2008) a immédiatement écarté l’éventualité d’une abrogation de la loi, en qualifiant la question référendaire de "ridicule". Mais la campagne du référendum a souligné une polarisation du christianisme néo-zélandais, entre d’un côté les représentants des principales églises historiques – y compris les églises baptistes – qui se sont rangées dans le camp du "oui", et de l’autre l’église restaurationiste de Brian Tamaki, Destiny Church et les réseaux évangéliques issus d’un "réveil
Ceux qui se sont déplacés pour voter – un peu plus d’un électeur sur deux – ont massivement répondu "non" (à 87%). Il faut dire que la question était assez clairement orientée... Le premier ministre conservateur John Key (élu en novembre 2008) a immédiatement écarté l’éventualité d’une abrogation de la loi, en qualifiant la question référendaire de "ridicule". Mais la campagne du référendum a souligné une polarisation du christianisme néo-zélandais, entre d’un côté les représentants des principales églises historiques – y compris les églises baptistes – qui se sont rangées dans le camp du "oui", et de l’autre l’église restaurationiste de Brian Tamaki, Destiny Church et les réseaux évangéliques issus d’un "réveil  charismatique" dans les années 1970, partisans du "non". Les sites Internet du oui et du non, toujours consultables, permettent d’identifier avec précision cette frontière, qui ne sépare pas simplement les partisans de la "fessée chrétienne" et ses opposants, mais plutôt d’un côté un christianisme qui inscrit son action dans le cadre de la sécularisation de la société néo-zélandaise et a pris acte du déclin du christianisme dans le pays (seulement 60% des Néo-zélandais s’identifient au christianisme) ; et de l’autre un christianisme militant qui s’oppose à la libéralisation des valeurs dominantes et invoque les "racines chrétiennes" de la nation face à une société de plus en plus multiconfessionnelle, multiculturelle et sécularisée.
charismatique" dans les années 1970, partisans du "non". Les sites Internet du oui et du non, toujours consultables, permettent d’identifier avec précision cette frontière, qui ne sépare pas simplement les partisans de la "fessée chrétienne" et ses opposants, mais plutôt d’un côté un christianisme qui inscrit son action dans le cadre de la sécularisation de la société néo-zélandaise et a pris acte du déclin du christianisme dans le pays (seulement 60% des Néo-zélandais s’identifient au christianisme) ; et de l’autre un christianisme militant qui s’oppose à la libéralisation des valeurs dominantes et invoque les "racines chrétiennes" de la nation face à une société de plus en plus multiconfessionnelle, multiculturelle et sécularisée.
 Au passage, Tapu Misa, une éditorialiste du quotidien national New Zealand Herald d’origine polynésienne, rappelait en décembre 2007 une des variables culturelles du débat sur la "loi anti-fessée": Les Pacific People (migrants polynésiens) représentent 6,9% de la population néo-zélandaise et la majeure partie des pratiquants réguliers dans les églises chrétiennes du pays. Leur soutien est activement recherché par la droite chrétienne, plutôt pakeha (Néo-zélandais d’origine européenne), qui y voit une réserve militante à condition de réussir à transformer les convictions éthiques et religieuse des Pacific People en
Au passage, Tapu Misa, une éditorialiste du quotidien national New Zealand Herald d’origine polynésienne, rappelait en décembre 2007 une des variables culturelles du débat sur la "loi anti-fessée": Les Pacific People (migrants polynésiens) représentent 6,9% de la population néo-zélandaise et la majeure partie des pratiquants réguliers dans les églises chrétiennes du pays. Leur soutien est activement recherché par la droite chrétienne, plutôt pakeha (Néo-zélandais d’origine européenne), qui y voit une réserve militante à condition de réussir à transformer les convictions éthiques et religieuse des Pacific People en  engagement politique conservateur. Mais ils restent pour le moment fidèles au parti travailliste. Et tout en reprenant en partie les stéréotypes culturels sur ces communautés polynésiennes (situées en bas de l’échelle sociale néo-zélandaise) qui voient dans "la culture polynésienne" l’explication d’une tolérance trop grande envers la violence, Tapu Misa préférait mettre en avant l’initiative du révérend Peniamina Vai et des ses paroissiens, qui ont fait de leur église congrégationaliste samoane d’Otara (un des quartiers polynésiens de la banlieue sud d’Auckland) une "zone sans violence" en bannissant les châtiments corporels.
engagement politique conservateur. Mais ils restent pour le moment fidèles au parti travailliste. Et tout en reprenant en partie les stéréotypes culturels sur ces communautés polynésiennes (situées en bas de l’échelle sociale néo-zélandaise) qui voient dans "la culture polynésienne" l’explication d’une tolérance trop grande envers la violence, Tapu Misa préférait mettre en avant l’initiative du révérend Peniamina Vai et des ses paroissiens, qui ont fait de leur église congrégationaliste samoane d’Otara (un des quartiers polynésiens de la banlieue sud d’Auckland) une "zone sans violence" en bannissant les châtiments corporels.
 Et en France ? Le débat avait été relancé en novembre 2010 par une proposition de loi contre les châtiments corporels déposée par la députée UMP Edwige Antier. Mais dans le grand public, il suscite souvent ricanements et hostilité, comme le montrent par exemple les commentaires qui suivent cet article publié le 15 novembre 2009 sur le site d’information Rue89. Un entretien avec Olivier Maurel, fondateur de l’observatoire sur la violence éducative ordinaire, paru dans Le Monde des religions et repris par le site Actu-chrétienne, permet d’avoir un aperçu plus précis des réactions dans les milieux évangéliques, majoritairement charismatiques et conservateurs, auxquels s’adresse ce site. Autrement dit, dans les milieux qui ont précisément été en pointe dans la mobilisation contre la loi anti-fessée néo-zélandaise.
Et en France ? Le débat avait été relancé en novembre 2010 par une proposition de loi contre les châtiments corporels déposée par la députée UMP Edwige Antier. Mais dans le grand public, il suscite souvent ricanements et hostilité, comme le montrent par exemple les commentaires qui suivent cet article publié le 15 novembre 2009 sur le site d’information Rue89. Un entretien avec Olivier Maurel, fondateur de l’observatoire sur la violence éducative ordinaire, paru dans Le Monde des religions et repris par le site Actu-chrétienne, permet d’avoir un aperçu plus précis des réactions dans les milieux évangéliques, majoritairement charismatiques et conservateurs, auxquels s’adresse ce site. Autrement dit, dans les milieux qui ont précisément été en pointe dans la mobilisation contre la loi anti-fessée néo-zélandaise.
Le premier commentaire réplique à O. Maurel qui citait un verset biblique (Matthieu 19:15, "si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi...") et mettait en avant "les propos du Christ sur les enfants [qui] sont les plus révolutionnaires de l’Evangile" pour exhorter les chrétiens à abandonner les  châtiments corporels. Au petit jeu des citations bibliques, il reste toutefois difficile de l’emporter... Les commentateurs de l’article de Topchrétien estimaient que le verset cité concerne tous les chrétiens et non simplement les enfants. "Donner une fessée, sans violence, haine, peut être salutaire", écrivait en outre le premier internaute ayant posté un commentaire, qui citait Proverbe 29:15 ("la verge et la correction donnent la sagesse, mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère") et Proverbe 23:13 ("N’épargne pas la correction à l’enfant ; si tu le frappes de la verge, il ne mourra point"). Pourtant, la tonalité générale des commentaires paraît finalement plus nuancée que ce qu’on pouvait lire sur Rue89 ou sur le site du Monde des religions. Dans ces milieux évangéliques où le rappel des rôles "naturels" du père et de la mère et des "valeurs familiales" nourrit par ailleurs de fortes mobilisations contre le mariage homosexuel, par exemple, une éventuelle loi anti-fessée n’apparaît pas, comme en Nouvelle-Zélande, comme une menace contre la "famille chrétienne". Et l’idée d’une éducation chrétienne non-violente revient dans plusieurs commentaires.
châtiments corporels. Au petit jeu des citations bibliques, il reste toutefois difficile de l’emporter... Les commentateurs de l’article de Topchrétien estimaient que le verset cité concerne tous les chrétiens et non simplement les enfants. "Donner une fessée, sans violence, haine, peut être salutaire", écrivait en outre le premier internaute ayant posté un commentaire, qui citait Proverbe 29:15 ("la verge et la correction donnent la sagesse, mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère") et Proverbe 23:13 ("N’épargne pas la correction à l’enfant ; si tu le frappes de la verge, il ne mourra point"). Pourtant, la tonalité générale des commentaires paraît finalement plus nuancée que ce qu’on pouvait lire sur Rue89 ou sur le site du Monde des religions. Dans ces milieux évangéliques où le rappel des rôles "naturels" du père et de la mère et des "valeurs familiales" nourrit par ailleurs de fortes mobilisations contre le mariage homosexuel, par exemple, une éventuelle loi anti-fessée n’apparaît pas, comme en Nouvelle-Zélande, comme une menace contre la "famille chrétienne". Et l’idée d’une éducation chrétienne non-violente revient dans plusieurs commentaires.
Même s’il ne s’agit ici que d’un rapide survol de la question, on peut à mon avis tenter quelques remarques ou hypothèses :
1 La première, c’est que les mobilisations évangéliques, depuis les années 1970-80, se nourrissent d’un sentiment minoritaire : l’impression que le christianisme n’inspire plus les normes sociales dominantes et que de nouvelles valeurs morales, libérales et sécularisées, tendent à s’imposer à l’ensemble de la société. Un commentateur du Monde des religions parle par exemple de "théories boboïsantes". Aux yeux de la droite chrétienne néo-zélandaise, le Green Party (initiateur de la loi) incarne par excellence ces nouvelles valeurs "boboïsantes", ce qui explique la virulence de sa réaction et l’équation établie entre fessée et famille chrétienne. En France, la proposition de loi est avancée par une députée UMP, par ailleurs pédiatre, et n’a pas reçu le soutien d’une quelconque intelligentsia progressiste. Elle ne suscite donc pas le sentiment d’être mis en minorité ou stigmatisés.
2 Deuxièmement, l’importance considérable qu’ont pris les questions d’éthique sexuelle et familiale dans les mobilisations chrétiennes, au détriment d’autres questions (socio-économiques, par exemple) tient en grande partie au fait qu’elles jouent aujourd’hui un rôle de repères identitaires dans les jeux de distinction au sein du christianisme. Elles permettent de matérialiser une frontière entre progressistes et conservateurs, entre le camp du progrès (dénoncé comme celui de la compromission par le camp adverse) et celui de la vérité biblique (conservatisme et étroitesse d’esprit pour le camp adverse). Ces jeux de distinction, les militants de la droite évangélique néo-zélandaises ont su les activer à l’occasion de la loi "anti-fessée". Mais on voit mal comment une telle stratégie pourrait fonctionner en France. Le contexte national, religieux et politique, reste donc une variable déterminante.
3 Enfin, dernière remarque, l’enjeu est moins d’être pour la fessée que contre son interdiction. "Que l’on nous laisse éduquer nos enfants comme on l’entend, il y en a ASSEZ que l’on vienne tout décider à notre place par des lois", écrit un commentateur sur Actu-chrétienne. Ce ressort important des mobilisations évangéliques, très présent dans le cas néo-zélandais, tend à rapprocher aujourd’hui la nouvelle droite chrétienne de ceux qu’on appelle aux Etats-Unis les libertariens et qui, à l’instar de Sarah Palin ou du Tea Party, réclament moins d’intervention de l’Etat dans la société. Mais ils rêvent aussi d’un "gouvernement chrétien" qui pourrait imposer des normes sociales inspirées d’une lecture conservatrice de la Bible à des citoyens pas forcément chrétiens, restreignant ainsi les libertés publiques...
Illustrations. courrier.mail.au ; news.bbc.uk ; manifestation du "no" (M. Mitchell, New Zealand Herald) ; "no" (familyintegrity.org.nz) ; Tapu Misa ; Congregational Church de Lalomanu (Samoa, stuff.co.nz) ; le-grand-duduche ; M. Ernst, "La Vierge Marie donnant une fessée à l'Enfant Jésus" (sur le site de l'Oratoire).
 océaniens: notamment à l'occasion de mes enquêtes de terrain en 2007 en Nouvelle-Zélande, où les Pacific Peoples venus des îles polynésiennes représentent désormais une large part des forces militantes des églises chrétiennes (voir par exemple la note sur le
océaniens: notamment à l'occasion de mes enquêtes de terrain en 2007 en Nouvelle-Zélande, où les Pacific Peoples venus des îles polynésiennes représentent désormais une large part des forces militantes des églises chrétiennes (voir par exemple la note sur le  Parce que l'Occident semble à leurs yeux en voie de déchristianisation, que le christianisme s'est ancré au fil du temps dans les cultures locales, ces chrétiens du Sud sont désormais nombreux - surtout en milieu évangélique, mais pas seulement - à regarder les anciennes puissances colonisatrices et missionnaires comme de nouvelles terres de mission. Ils revendiquent aussi, de plus en plus souvent, le christianisme comme une part de leur identité culturelle distinctive, ce qui marque une rupture avec le discours classique du protestantisme évangélique sur la "nouvelle identité en Christ", synonyme de mise à distance des traditions et des appartenances culturelles "obligées".
Parce que l'Occident semble à leurs yeux en voie de déchristianisation, que le christianisme s'est ancré au fil du temps dans les cultures locales, ces chrétiens du Sud sont désormais nombreux - surtout en milieu évangélique, mais pas seulement - à regarder les anciennes puissances colonisatrices et missionnaires comme de nouvelles terres de mission. Ils revendiquent aussi, de plus en plus souvent, le christianisme comme une part de leur identité culturelle distinctive, ce qui marque une rupture avec le discours classique du protestantisme évangélique sur la "nouvelle identité en Christ", synonyme de mise à distance des traditions et des appartenances culturelles "obligées".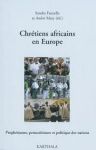 Les anthropologues des christianismes africains ont été parmi les premiers à s'intéresser à ces nouvelles dynamiques religieuses. Ils ont aussi été amenés à suivre la piste des migrations internationales, en étudiant notamment les églises implantées par les migrants africains en Europe. Un
Les anthropologues des christianismes africains ont été parmi les premiers à s'intéresser à ces nouvelles dynamiques religieuses. Ils ont aussi été amenés à suivre la piste des migrations internationales, en étudiant notamment les églises implantées par les migrants africains en Europe. Un  C'est dans le prolongement de cette réflexion collective que s'inscrit la journée d'étude "Protestantisme évangélique et diversité culturelle" que j'organise avec Gwendoline Malogne-Fer, le 19 octobre prochain à la Maison de la recherche de l'université Toulouse le Mirail. Vous trouverez ci-dessous l'argumentaire et le programme détaillé de cette journée, qui donnera lieu à une publication. Le programme peut aussi être téléchargé
C'est dans le prolongement de cette réflexion collective que s'inscrit la journée d'étude "Protestantisme évangélique et diversité culturelle" que j'organise avec Gwendoline Malogne-Fer, le 19 octobre prochain à la Maison de la recherche de l'université Toulouse le Mirail. Vous trouverez ci-dessous l'argumentaire et le programme détaillé de cette journée, qui donnera lieu à une publication. Le programme peut aussi être téléchargé  Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme
Le samedi 6 août 2011, quatre jeunes Kanaks sont morts sur l’île de Maré (Nouvelle-Calédonie) à la suite d’affrontements entre un collectif d’usagers d’Air Calédonie (Aircal) qui bloquait l’aéroport local et des habitants du district de Guahma venus les déloger. Dans un premier temps, les médias ont évoqué les tensions nées de ce blocage (maintenu depuis le 22 juillet) pour expliquer l’explosion de violence: un mouvement de protestation contre la hausse des tarifs mise en place dans le cadre du redressement de la compagnie aérienne, qui relie notamment les îles Loyauté (dont Maré fait partie) à Nouméa et représente donc un enjeu important pour les habitants de ces îles. Puis des comptes rendus plus approfondis ont été publiés, comme  cet article du 9 août (
cet article du 9 août ( des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880.
des îles Cook, envoyés par la London Missionary Society. Ils sont arrivés à Maré en 1841 et ont été accueillis par le chef Naisseline (ancêtre de l’actuel chef de l’île) qui s’est converti au protestantisme. Des missionnaires britanniques les ont rejoints en 1854. Trois ans plus tard, l’implantation de la mission catholique dans les îles Loyauté, soutenue par la France (qui avait annexé la Nouvelle-Calédonie en 1853) crée de vives tensions sur l’île : les distinctions religieuses recoupent des rivalités internes, entre chefferies kanakes, et suscitent des conflits fonciers. Quand deux missionnaires maristes cherchent à s’implanter en s’alliant avec un chef opposé au protestantisme, devenu majoritaire sur l’île, ils sont rapidement accusés d’avoir empiéter sur le territoire du chef protestant Naisseline, et doivent quitter l’île en 1870. A leur retour en 1875, les tensions ressurgissent, au point que le gouverneur décide de tracer des lignes de démarcation. Les troubles se poursuivent tout au long des années 1870 et 1880. observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions.
observable dans la plupart des sociétés océaniennes: d’un côté, les appartenances religieuses produisent ou renforcent des divisions, notamment au sein des communautés insulaires, des villages. De l’autre, le christianisme est devenu dans beaucoup d’îles du Pacifique une référence commune, inscrite dans les Constitutions des Etats océaniens comme un élément fondateur de l’identité nationale. Une référence qui peut donc permettre – en dépassant les distinctions confessionnelles – d’apaiser des conflits et de surmonter de graves divisions.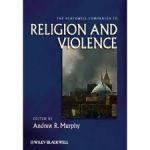 Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le
Dans un chapitre que j’ai publié cette année («Religion, Pluralism and Conflicts in the Pacific Islands») dans le  inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles.
inédite, rompant avec la barbarie des affrontements antérieurs. Les missions chrétiennes ont effectivement éradiqué les violences rituelles et imposé par des jeux d’alliances politiques une «Pax Christiana» en unifiant les communautés insulaires, le plus souvent sous l’autorité d’un roi converti. Mais elles ont aussi contribué dans beaucoup d’endroits, au moins dans un premier temps, à raviver des rivalités et des tensions entre communautés, désormais divisées aussi par les frontières confessionnelles.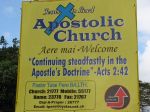 évangéliques, le plus souvent pentecôtistes, ou l’implantation d’autres églises minoritaires – adventistes, mormons, témoins de Jéhovah – a suscité de vives tensions dans plusieurs îles et villages polynésiens. En 2000, par exemple, la Cour suprême de Samoa a dû rappeler le principe constitutionnel de liberté religieuse, face aux chefs traditionnels (matai) du village de Saipipi, qui avaient expulsé 32 personnes ayant organisé des études bibliques d’inspiration évangélique sur un terrain communautaire. En 2006, en dépit d’un arrêt de la Haute Cour de Tuvalu, un conseil d’anciens d’un des villages de cette île polynésienne persistait à menacer d’expulsion un groupe de fonctionnaires membres d’une église
évangéliques, le plus souvent pentecôtistes, ou l’implantation d’autres églises minoritaires – adventistes, mormons, témoins de Jéhovah – a suscité de vives tensions dans plusieurs îles et villages polynésiens. En 2000, par exemple, la Cour suprême de Samoa a dû rappeler le principe constitutionnel de liberté religieuse, face aux chefs traditionnels (matai) du village de Saipipi, qui avaient expulsé 32 personnes ayant organisé des études bibliques d’inspiration évangélique sur un terrain communautaire. En 2006, en dépit d’un arrêt de la Haute Cour de Tuvalu, un conseil d’anciens d’un des villages de cette île polynésienne persistait à menacer d’expulsion un groupe de fonctionnaires membres d’une église  Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur
Le cas le plus exemplaire est sans doute celui des îles Salomon, où la Solomon Islands Christian Association, qui regroupe un ensemble d’églises représentant 90% de la population de cet Etat mélanésien, est intervenue au tournant des années 2000 pour apaiser une grave crise politique et mettre fin aux affrontements entre les milices de Malaita et celles des habitants de Guadalcanal qui cherchaient à expulser ces communautés migrantes installées notamment près de la capitale Honiara. Les responsables d'églises chrétiennes réunis en équipe interdénominationnelle (dirigée par un pasteur 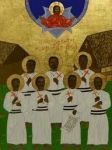 adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix.
adventiste) sont alors apparues comme les seuls acteurs capables de dépasser les clivages insulaires pour renouer le dialogue entre les belligérants et aboutir à un accord de paix en octobre 2000. Les Melanesian Brothers, un ordre religieux anglican, ont en outre gagné au cours de cette crise une aura considérable, en s’interposant constamment entre les milices et en libérant de nombreux otages. Une aura qui a pris en 2003 la dimension du martyr, quand sept frères ont été assassinés par un adversaire irréductible des accords de paix.