 Si les débats houleux sur l’ordination de prêtres ou pasteurs homosexuels occupent souvent le devant de la scène, la question de l’ordination des femmes continue de se poser à de nombreuses églises protestantes dans le monde. En France, l’église réformée – qui comptait dès 1949 quelques femmes pasteures – reconnaît le pastorat féminin, officiellement et sans restriction (l’obligation de célibat pour ces femmes ayant alors été levée) depuis 1966. Mais ce n’est qu’en 2005 que la fédération baptiste a franchi le pas. Les assemblées de Dieu y sont encore réticentes, en dépit des nombreux exemples donnés par d’autres assemblées de tous les continents.
Si les débats houleux sur l’ordination de prêtres ou pasteurs homosexuels occupent souvent le devant de la scène, la question de l’ordination des femmes continue de se poser à de nombreuses églises protestantes dans le monde. En France, l’église réformée – qui comptait dès 1949 quelques femmes pasteures – reconnaît le pastorat féminin, officiellement et sans restriction (l’obligation de célibat pour ces femmes ayant alors été levée) depuis 1966. Mais ce n’est qu’en 2005 que la fédération baptiste a franchi le pas. Les assemblées de Dieu y sont encore réticentes, en dépit des nombreux exemples donnés par d’autres assemblées de tous les continents.Dans les îles du Pacifique, c’est la United Church of Papua New Guinea qui a été, en 1976, la première église protestante à ordonner des femmes. L’église protestante de Kiribati a suivi en 1984, la Free Wesleyan Church de Tonga en 1990. Dans cette église, la plupart des femmes ordonnées occupaient des postes d’enseignantes ou de principales dans les Colleges méthodistes, responsabilités qu’elles ont généralement conservées après l’ordination, qui vaut surtout reconnaissance de leur contribution à la vie de l’église et du rôle essentiel qu’y jouent les écoles. En 1991, l’église évangélique en Nouvelle-Calédonie et aux îles Loyauté a rejoint le mouvement.
En revanche, les églises protestantes historiques des îles Cook (Cook Islands Christian Church) et de Samoa (méthodiste et Congregational) s’y refusent toujours. Les premières femmes samoanes ordonnées pasteures l’ont été en Nouvelle-Zélande, où vit une importante communauté samoane (130 000 en 2006) : elles sont aujourd’hui pasteures au sein des églises presbytérienne et méthodiste néo-zélandaise, le plus souvent dans des paroisses pakeha (Néo-zélandais d’origine européenne).
Le livre que vient de publier Gwendoline Malogne-Fer aux éditions Karthala, Les femmes dans l’église protestante ma’ohi. Religion, genre et pouvoir en Polynésie française, prend le temps d’analyser en détail tous les enjeux liés à l’accession de ces femmes aux responsabilités d’église, à travers le cas de l’église protestante historique de Polynésie française.Cette église, qui rassemble aujourd’hui environ 40% de la population, a autorisé les femmes à devenir pasteures en 1995, après de longues années de discussion et à la faveur de ce que l’ancien secrétaire général de l’église, Ralph Teinaore, qualifiait en 2001 de «coup d’État»:
Religion, genre et pouvoir en Polynésie française, prend le temps d’analyser en détail tous les enjeux liés à l’accession de ces femmes aux responsabilités d’église, à travers le cas de l’église protestante historique de Polynésie française.Cette église, qui rassemble aujourd’hui environ 40% de la population, a autorisé les femmes à devenir pasteures en 1995, après de longues années de discussion et à la faveur de ce que l’ancien secrétaire général de l’église, Ralph Teinaore, qualifiait en 2001 de «coup d’État»:
 Religion, genre et pouvoir en Polynésie française, prend le temps d’analyser en détail tous les enjeux liés à l’accession de ces femmes aux responsabilités d’église, à travers le cas de l’église protestante historique de Polynésie française.Cette église, qui rassemble aujourd’hui environ 40% de la population, a autorisé les femmes à devenir pasteures en 1995, après de longues années de discussion et à la faveur de ce que l’ancien secrétaire général de l’église, Ralph Teinaore, qualifiait en 2001 de «coup d’État»:
Religion, genre et pouvoir en Polynésie française, prend le temps d’analyser en détail tous les enjeux liés à l’accession de ces femmes aux responsabilités d’église, à travers le cas de l’église protestante historique de Polynésie française.Cette église, qui rassemble aujourd’hui environ 40% de la population, a autorisé les femmes à devenir pasteures en 1995, après de longues années de discussion et à la faveur de ce que l’ancien secrétaire général de l’église, Ralph Teinaore, qualifiait en 2001 de «coup d’État»:Alors que tout le monde était focalisé sur la décision de Chirac de reprendre les essais nucléaires, alors comme tous les esprits étaient tournés vers là [on a demandé] "et les femmes?" "Les femmes?" "Ok !" Parce que personne ne voulait en discuter. (p. 198)
- Les femmes, le mariage et l’élaboration d’un modèle paroissial fondé sur le "couple pastoral"
La première partie du livre prend pour point de départ le regard des missionnaires de la London Missionary Society (LMS) sur la société polynésienne et les femmes en particulier, regard qui les amène à placer l’institution du mariage au cœur de leur projet missionnaire. Il y a d’abord le refus, exprimé dès 1797 (année de l’arrivée du premier bateau de la LMS à Tahiti) par les responsables de la mission, de laisser les missionnaires célibataires épouser des Tahitiennes, sous prétexte qu’elles ne «sont pas chrétiennes». Henri Nott, qui voulait épouser une Tahitienne convertie, ne réussit pourtant pas à faire accepter son projet par ses confrères et épousa finalement une Anglaise… comme tous les autres missionnaires anglais qui, à partir de 1806, doivent se marier avant de partir en Polynésie.
Curieusement, cette obligation du mariage a été reprise ensuite pour les pasteurs polynésiens et s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui. Etre marié était même, jusque dans les années 1960, une obligation pour ceux qui souhaitaient devenir membres d’église (etaretia). Car les missionnaires ont vu dans le mariage un élément essentiel de «civilisation» des mœurs polynésiennes, d’une part pour mettre en place des «familles chrétiennes» centrées sur le couple et ses enfants et d’autre part pour encadrer une sexualité qui leur paraissait trop débridée.
 L’idée que les femmes devaient être des agents privilégiés de cette christianisation des mœurs polynésiennes, associée à l’insistance mise sur le couple conjugal, explique très largement le fonctionnement traditionnel de la paroisse tel qu’on l’observe encore aujourd’hui. D’un côté, des activités spécifiques aux femmes (comités des femmes, ateliers couture, réunions bibliques, etc…), héritage des cours de «rattrapage» souvent animés par les épouses de missionnaires. De l’autre, un «couple pastoral» au sein duquel l’épouse de pasteur remplit un rôle essentiel, que Gwendoline Malogne-Fer décrit comme un «ministère dérivé» : si le mari est le pasteur en titre, officiellement reconnu et rétribué, il ne peut faire fonctionner la paroisse sans «Madame Pasteur» (Orometua Vahine) qui, par son travail bénévole lui permet de maîtriser tout ce qui s’y passe, y compris du côté des femmes.
L’idée que les femmes devaient être des agents privilégiés de cette christianisation des mœurs polynésiennes, associée à l’insistance mise sur le couple conjugal, explique très largement le fonctionnement traditionnel de la paroisse tel qu’on l’observe encore aujourd’hui. D’un côté, des activités spécifiques aux femmes (comités des femmes, ateliers couture, réunions bibliques, etc…), héritage des cours de «rattrapage» souvent animés par les épouses de missionnaires. De l’autre, un «couple pastoral» au sein duquel l’épouse de pasteur remplit un rôle essentiel, que Gwendoline Malogne-Fer décrit comme un «ministère dérivé» : si le mari est le pasteur en titre, officiellement reconnu et rétribué, il ne peut faire fonctionner la paroisse sans «Madame Pasteur» (Orometua Vahine) qui, par son travail bénévole lui permet de maîtriser tout ce qui s’y passe, y compris du côté des femmes.
 L’idée que les femmes devaient être des agents privilégiés de cette christianisation des mœurs polynésiennes, associée à l’insistance mise sur le couple conjugal, explique très largement le fonctionnement traditionnel de la paroisse tel qu’on l’observe encore aujourd’hui. D’un côté, des activités spécifiques aux femmes (comités des femmes, ateliers couture, réunions bibliques, etc…), héritage des cours de «rattrapage» souvent animés par les épouses de missionnaires. De l’autre, un «couple pastoral» au sein duquel l’épouse de pasteur remplit un rôle essentiel, que Gwendoline Malogne-Fer décrit comme un «ministère dérivé» : si le mari est le pasteur en titre, officiellement reconnu et rétribué, il ne peut faire fonctionner la paroisse sans «Madame Pasteur» (Orometua Vahine) qui, par son travail bénévole lui permet de maîtriser tout ce qui s’y passe, y compris du côté des femmes.
L’idée que les femmes devaient être des agents privilégiés de cette christianisation des mœurs polynésiennes, associée à l’insistance mise sur le couple conjugal, explique très largement le fonctionnement traditionnel de la paroisse tel qu’on l’observe encore aujourd’hui. D’un côté, des activités spécifiques aux femmes (comités des femmes, ateliers couture, réunions bibliques, etc…), héritage des cours de «rattrapage» souvent animés par les épouses de missionnaires. De l’autre, un «couple pastoral» au sein duquel l’épouse de pasteur remplit un rôle essentiel, que Gwendoline Malogne-Fer décrit comme un «ministère dérivé» : si le mari est le pasteur en titre, officiellement reconnu et rétribué, il ne peut faire fonctionner la paroisse sans «Madame Pasteur» (Orometua Vahine) qui, par son travail bénévole lui permet de maîtriser tout ce qui s’y passe, y compris du côté des femmes.- Femmes de pasteurs, comités des femmes et organisations œcuméniques internationales
C’est à l’intersection de ces deux dynamiques – les femmes «entre elles» et le «ministère dérivé» d’épouse de pasteur – qu’ont émergé progressivement les conditions d’une accession des femmes au pastorat. D’abord, il y a eu des femmes diacres (surtout à partir des années 1980), qui ont souvent acquis une légitimité au sein de l’église par leur capacité de travail et leur sérieux – là où les hommes diacres sont parfois critiqués pour se contenter des honneurs de la fonction et ne pas être assez à l’écoute des paroissiens.
Puis, des épouses de pasteurs ont eu accès à la même formation théologique que leurs maris, notamment au Pacific Theological College de Suva (Fidji) et ont même été diplômées en théologie. La question a alors commencé à se poser: ne seraient-elles pas aussi capables que leur mari d’exercer les fonctions pastorales?
 Mais c’est surtout lorsque des femmes de pasteurs ont été sollicitées pour participer aux réunions des organisations œcuméniques internationales, comme le Conseil œcuménique des églises et sa déclinaison régionale, la Pacific Conference of Churches, que la pression sur les dirigeants de l’église s’est accentuée: ces organisations, très engagées en faveur de l’égalité hommes-femmes, sont aussi des lieux de rencontre, où les femmes polynésiennes ont découvert que beaucoup d’ «églises sœurs» du Pacifique avaient déjà des femmes pasteures. Dès lors, elles n’ont pas cessé de réclamer la même décision aux instances dirigeantes de leur église. Et pour pouvoir préparer ces réunions internationales et en rendre compte, elles ont mis en place dans toutes les paroisses polynésiennes des comités des femmes, qui ont souvent été le lieu de discussion sur la place des femmes dans l’église.
Mais c’est surtout lorsque des femmes de pasteurs ont été sollicitées pour participer aux réunions des organisations œcuméniques internationales, comme le Conseil œcuménique des églises et sa déclinaison régionale, la Pacific Conference of Churches, que la pression sur les dirigeants de l’église s’est accentuée: ces organisations, très engagées en faveur de l’égalité hommes-femmes, sont aussi des lieux de rencontre, où les femmes polynésiennes ont découvert que beaucoup d’ «églises sœurs» du Pacifique avaient déjà des femmes pasteures. Dès lors, elles n’ont pas cessé de réclamer la même décision aux instances dirigeantes de leur église. Et pour pouvoir préparer ces réunions internationales et en rendre compte, elles ont mis en place dans toutes les paroisses polynésiennes des comités des femmes, qui ont souvent été le lieu de discussion sur la place des femmes dans l’église.- Les enjeux: professionnalisation, formation, théologie
G. Malogne-Fer montre que la question du pastorat des femmes ne se réduit pas à la redéfinition des identités de sexe et des rôles de l’homme ou de la femme dans la société polynésienne contemporaine, même si les femmes pasteures ont parfois des difficultés à concilier leur identité féminine avec l’image traditionnelle de la fonction pastorale. Elle comporte aussi des enjeux de pouvoir et s’inscrit dans un contexte plus large d’interrogations sur le rôle de l’église, sa conception de l’autorité, sa théologie et ses rapports ambigus avec la logique scolaire.
L’entrée des femmes à l’école pastorale coïncide en effet avec l’élévation du niveau de diplôme exigé, et beaucoup de paroissiens y voient à la fois une mesure qui avantage trop nettement les femmes (meilleures à l’école!), qui fait du pastorat une affaire «d’intellectuels» au détriment de la foi et éloigne les pasteurs de la culture polynésienne en privilégiant les connaissances dispensées par l’école française. L’analyse des parcours de ces femmes permet de comprendre la manière dont elles-mêmes interprètent leur réussite scolaire et comment elles vivent le fait d’être souvent soupçonnées de ne pas être assez «ma’ohi» (polynésiennes, autochtones).
et beaucoup de paroissiens y voient à la fois une mesure qui avantage trop nettement les femmes (meilleures à l’école!), qui fait du pastorat une affaire «d’intellectuels» au détriment de la foi et éloigne les pasteurs de la culture polynésienne en privilégiant les connaissances dispensées par l’école française. L’analyse des parcours de ces femmes permet de comprendre la manière dont elles-mêmes interprètent leur réussite scolaire et comment elles vivent le fait d’être souvent soupçonnées de ne pas être assez «ma’ohi» (polynésiennes, autochtones).
L’arrivée des femmes pasteures amplifie aussi les évolutions du pastorat amorcées dans les années 1960, avec la montée des ministères non paroissiaux (comme les aumôniers) qui paraissent plus en phase avec la société d’aujourd’hui et permettent surtout à ces femmes de trouver leur place dans une église où le ministère en paroisse reste fondé sur le modèle traditionnel de l’homme pasteur aidé de son épouse.
L’entrée des femmes à l’école pastorale coïncide en effet avec l’élévation du niveau de diplôme exigé,
 et beaucoup de paroissiens y voient à la fois une mesure qui avantage trop nettement les femmes (meilleures à l’école!), qui fait du pastorat une affaire «d’intellectuels» au détriment de la foi et éloigne les pasteurs de la culture polynésienne en privilégiant les connaissances dispensées par l’école française. L’analyse des parcours de ces femmes permet de comprendre la manière dont elles-mêmes interprètent leur réussite scolaire et comment elles vivent le fait d’être souvent soupçonnées de ne pas être assez «ma’ohi» (polynésiennes, autochtones).
et beaucoup de paroissiens y voient à la fois une mesure qui avantage trop nettement les femmes (meilleures à l’école!), qui fait du pastorat une affaire «d’intellectuels» au détriment de la foi et éloigne les pasteurs de la culture polynésienne en privilégiant les connaissances dispensées par l’école française. L’analyse des parcours de ces femmes permet de comprendre la manière dont elles-mêmes interprètent leur réussite scolaire et comment elles vivent le fait d’être souvent soupçonnées de ne pas être assez «ma’ohi» (polynésiennes, autochtones).L’arrivée des femmes pasteures amplifie aussi les évolutions du pastorat amorcées dans les années 1960, avec la montée des ministères non paroissiaux (comme les aumôniers) qui paraissent plus en phase avec la société d’aujourd’hui et permettent surtout à ces femmes de trouver leur place dans une église où le ministère en paroisse reste fondé sur le modèle traditionnel de l’homme pasteur aidé de son épouse.
- Et le mari de la femme pasteure?
Une question préoccupe beaucoup de paroissiens à l’idée qu’une femme puisse un jour diriger leur paroisse: que va t-on faire de son mari? Cet embarras traduit, souligne G. Malogne-Fer, les limites du modèle conjugal car quand la femme devient pasteure, les choses commencent soudain à ne plus tourner tout à fait rond… Le conjoint, supposé être une aide, devient ici un problème. Il paraît difficile de lui confier le rôle traditionnel du conjoint de pasteur – animer les activités des femmes – ou de l’obliger à se consacrer entièrement à la vie paroissiale (il vaut mieux qu’il ait un emploi à l’extérieur). La vie conjugale de la femme pasteure devient un sujet de préoccupation pour la paroisse: on craint qu’elle ne s’avise de rabaisser son mari, non seulement dans la paroisse mais aussi dans son couple. Et une femme qui «ne respecte pas son mari» en le maintenant dans une position inférieure ne manque-t-elle pas aussi, du même coup, de respect vis-à-vis de ses paroissiens?
Les maris de pasteures auraient tout à gagner à une séparation stricte de la vie privée et du ministère, qui n’est pas encore acquise. En attendant le jour où l’église acceptera officiellement les pasteur(e)s célibataires ou, comme c’est le cas dans de nombreuses églises du Pacifique, d’ordonner des couples pasteurs: pas un homme pasteur aidé de son épouse bénévole, ni une femme pasteure et son mari, mais tout simplement un pasteur marié… à une pasteure.
Google Books. Des extraits de ce livre sont désormais disponibles sur Google Books, pour les lire, cliquez ici.
Illustrations:
- Rassemblement des femmes de l'église à Tipaerui, Tahiti, en 2001 (G. Malogne-Fer).
- Logo du Conseil oecuménique des églises.
 Dimanche 16 décembre 2007 à 17 heures, l’
Dimanche 16 décembre 2007 à 17 heures, l’ consumérisme n’apporte pas la «paix durable» de la conversion, il y aura quand même eu un peu plus tôt un heureux gagnant dans la salle, lorsque John Cameron invite les spectateurs à regarder sous leur siège à la recherche d’une petite pastille de couleur, pour gagner... un lecteur Mp3 !
consumérisme n’apporte pas la «paix durable» de la conversion, il y aura quand même eu un peu plus tôt un heureux gagnant dans la salle, lorsque John Cameron invite les spectateurs à regarder sous leur siège à la recherche d’une petite pastille de couleur, pour gagner... un lecteur Mp3 ! Elles sont pourtant plusieurs à y rencontrer un certain succès, en adaptant leur mode d’expression (musique et format des cultes), leur discours (style «jeune», prédications souvent plus courtes) et leur organisation (Life groups, réunions et cultes de jeunes). Certaines ont conservé une étiquette dénominationnelle classique, comme la
Elles sont pourtant plusieurs à y rencontrer un certain succès, en adaptant leur mode d’expression (musique et format des cultes), leur discours (style «jeune», prédications souvent plus courtes) et leur organisation (Life groups, réunions et cultes de jeunes). Certaines ont conservé une étiquette dénominationnelle classique, comme la  pêche. Ils n’ont pas encore parlé de religion, mais ça viendra sans doute… on peut difficilement faire plus soft. L’organisation de l’église est elle aussi plus relationnelle qu’institutionnelle. Une logique de désinstitutionalisation liée à l’évolution de la société néo-zélandaise contemporaine? Pas seulement, car The Street n’est pas une église récente créée pour capter l’air du temps : c’est en fait l’une des plus anciennes églises évangéliques de Wellington, issue du mouvement darbyste des Open Brethren (les «frères larges»). Son histoire remonte à 1913, lorsque l’assemblée de Vivian Street décide de se tourner vers les familles déshéritées du centre-ville, une mission qui a donné naissance à une église dix ans plus tard et construit un bâtiment en 1928. Dans les années 1950, elle déménage à Elisabeth Street, au pied du mont Victoria. Son nom officiel est alors the Elisabeth Street Church, mais on la désigne plus couramment par l’abréviation «E Street». En 2002, la croissance de l’église conduit à un nouveau déménagement, sur Hania Street, le E disparaît et l’église ne garde finalement que le nom de «The Street».
pêche. Ils n’ont pas encore parlé de religion, mais ça viendra sans doute… on peut difficilement faire plus soft. L’organisation de l’église est elle aussi plus relationnelle qu’institutionnelle. Une logique de désinstitutionalisation liée à l’évolution de la société néo-zélandaise contemporaine? Pas seulement, car The Street n’est pas une église récente créée pour capter l’air du temps : c’est en fait l’une des plus anciennes églises évangéliques de Wellington, issue du mouvement darbyste des Open Brethren (les «frères larges»). Son histoire remonte à 1913, lorsque l’assemblée de Vivian Street décide de se tourner vers les familles déshéritées du centre-ville, une mission qui a donné naissance à une église dix ans plus tard et construit un bâtiment en 1928. Dans les années 1950, elle déménage à Elisabeth Street, au pied du mont Victoria. Son nom officiel est alors the Elisabeth Street Church, mais on la désigne plus couramment par l’abréviation «E Street». En 2002, la croissance de l’église conduit à un nouveau déménagement, sur Hania Street, le E disparaît et l’église ne garde finalement que le nom de «The Street». Dans la vallée qui conduit vers Johnsonville et Porirua, au nord de Wellington, l’église
Dans la vallée qui conduit vers Johnsonville et Porirua, au nord de Wellington, l’église  Le 10 octobre 2007, le
Le 10 octobre 2007, le  ont connu de nombreuses scissions depuis leur fondation au cours des années 1920. Leur histoire vient d’être retracée par Ian G. Clark, dans un livre paru en 2007, Pentecost at the Ends of the Earth. On y apprend que le pasteur d’origine indienne, Tak Bhana, qui dirige aujourd’hui le WCCC, a été recruté en 1988 suite à une «crise de leadership» ayant entraîné le départ du précédent pasteur. Au cours des dix années suivantes, l’église est devenue l’une des plus dynamiques et des plus grandes assemblées de Dieu de Nouvelle-Zélande. Mais en 1998, elle a finalement quitté les assemblées de Dieu pour devenir une église indépendante.
ont connu de nombreuses scissions depuis leur fondation au cours des années 1920. Leur histoire vient d’être retracée par Ian G. Clark, dans un livre paru en 2007, Pentecost at the Ends of the Earth. On y apprend que le pasteur d’origine indienne, Tak Bhana, qui dirige aujourd’hui le WCCC, a été recruté en 1988 suite à une «crise de leadership» ayant entraîné le départ du précédent pasteur. Au cours des dix années suivantes, l’église est devenue l’une des plus dynamiques et des plus grandes assemblées de Dieu de Nouvelle-Zélande. Mais en 1998, elle a finalement quitté les assemblées de Dieu pour devenir une église indépendante.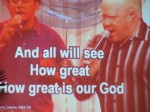 Musique rock, gospel ou groupes culturels, les cultes du WCCC sont un spectacle efficace et professionnel, dont on peut d'ailleurs acheter l’enregis- trement sur DVD. Les prédications du pasteur Bhana cherchent avant tout à être percutantes, comme ce dimanche soir 14 octobre où de 18h à 19h, le culte est axé sur la disparition des «peurs» : en une heure chrono, grâce à la prière et à la lecture de quelques versets-clés, vous allez vous débarrasser de toutes vos peurs, annonce-t-il, avant de conclure la réunion par le traditionnel appel à ceux qui veulent «donner leur cœur à Jésus»…. jusqu’au compte à rebours final, car la réunion se termine à 19h pile. Dans la salle, des Néo-zélandais de toutes origines et de tous âges, y compris des jeunes qui, dans leur ensemble, ont pourtant tendance à déserter les églises.
Musique rock, gospel ou groupes culturels, les cultes du WCCC sont un spectacle efficace et professionnel, dont on peut d'ailleurs acheter l’enregis- trement sur DVD. Les prédications du pasteur Bhana cherchent avant tout à être percutantes, comme ce dimanche soir 14 octobre où de 18h à 19h, le culte est axé sur la disparition des «peurs» : en une heure chrono, grâce à la prière et à la lecture de quelques versets-clés, vous allez vous débarrasser de toutes vos peurs, annonce-t-il, avant de conclure la réunion par le traditionnel appel à ceux qui veulent «donner leur cœur à Jésus»…. jusqu’au compte à rebours final, car la réunion se termine à 19h pile. Dans la salle, des Néo-zélandais de toutes origines et de tous âges, y compris des jeunes qui, dans leur ensemble, ont pourtant tendance à déserter les églises. L’église compte deux auditoriums de plus de mille places, entourés comme il se doit de grands parkings. Elle a ses propres activités missionnaires, en Chine, aux îles Salomon et au Cambodge, où une église a été implantée. Début octobre, une douzaine de jeunes de l’église reviennent justement d’un séjour missionnaire au Cambodge, dont ils présentent un compte rendu en ouverture du culte du 14 octobre.
L’église compte deux auditoriums de plus de mille places, entourés comme il se doit de grands parkings. Elle a ses propres activités missionnaires, en Chine, aux îles Salomon et au Cambodge, où une église a été implantée. Début octobre, une douzaine de jeunes de l’église reviennent justement d’un séjour missionnaire au Cambodge, dont ils présentent un compte rendu en ouverture du culte du 14 octobre.