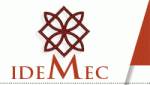 Du 26 au 28 novembre 2008 a eu lieu à la Maison méditéranéenne des sciences de l'homme (MMSH), à l'invitation de l'anthropologue Christophe Pons et avec le soutien du CNRS, de l'Université de Provence et de l'IDEMEC, un colloque intitulé "Les négociations avec et dans le religieux" auquel j'ai participé. Mon intervention était intitulée "Ce n'est pas l'église qui sauve, mais... Les négociations entre individus et autorité institutionnelle au sein du pentecôtisme classique". Grâce à la phonotèque de la MMSH, l'enregistrement de cette intervention (40 minutes d'exposé et 20 minutes de débat) est désormais accessible en ligne : vous pouvez l'écouter en cliquant sur "individus & institution en pentecôtisme" dans la colonne de gauche - rubrique "à écouter" - ou en cliquant ici.
Du 26 au 28 novembre 2008 a eu lieu à la Maison méditéranéenne des sciences de l'homme (MMSH), à l'invitation de l'anthropologue Christophe Pons et avec le soutien du CNRS, de l'Université de Provence et de l'IDEMEC, un colloque intitulé "Les négociations avec et dans le religieux" auquel j'ai participé. Mon intervention était intitulée "Ce n'est pas l'église qui sauve, mais... Les négociations entre individus et autorité institutionnelle au sein du pentecôtisme classique". Grâce à la phonotèque de la MMSH, l'enregistrement de cette intervention (40 minutes d'exposé et 20 minutes de débat) est désormais accessible en ligne : vous pouvez l'écouter en cliquant sur "individus & institution en pentecôtisme" dans la colonne de gauche - rubrique "à écouter" - ou en cliquant ici.
J'ajoute un résumé permettant de voir plus précisément de quoi il s'agit:
Basée sur des enquêtes de terrain au sein des assemblées de Dieu de Polynésie française, cette communication analyse la manière dont le pentecôtisme classique s’efforce, par le biais d’un travail institutionnel "invisible", de faire vivre aux convertis des dispositifs d’encadrement objectivement contraignants sur le registre subjectif d’une "relation personnelle avec Dieu". Cette expérience religieuse, que l’on peut décrire comme un individualisme enchanté, repose sur plusieurs médiations spécifiques permettant aux membres d’église d’entendre "la voix de Dieu". Elle ouvre des espaces d’incertitudes, de tensions, donc de négociations et de compromis entre les individus et les représentants de l’autorité institutionnelle. Il est en effet difficile de réaliser la conciliation parfaite et durable entre d’une part, l’idée que "ce n’est pas l’église qui sauve" mais uniquement la relation intime que chacun établit avec Dieu ; et d’autre part la nécessité d’un changement effectif des existences personnelles impliquant une intervention institutionnelle efficace. Les trois principaux espaces où se joue la négociation portent sur la capacité à "faire parler Dieu", sur la régulation institutionnelle de la diversité des pratiques individuelles et sur la notion d’appartenance.
 Dans la plupart des îles polynésiennes, l'arrivée des premiers missionnaires (généralement protestants) est commémorée chaque année par des rassemblements où l'on chante, danse et rejoue la scène inaugurale, celle de la rencontre entre d'un côté les missionnaires européens ou les "teachers" - notamment ceux des îles de la Société ,qui les ont secondés dès le début du 19ème siècle - et de l'autre, les populations locales. Ainsi, en Polynésie française, le 5 mars - férié - est officiellement jour de "l'arrivée de l'Évangile", en souvenir de l'arrivée à Tahiti en 1797 du voilier le Duff afrêté par la London Missionary Society. À cette date tahitienne, plusieurs îles ont ajouté des cérémonies rappelant le jour où le christianisme est parvenu jusqu'à elles. La mise en scène de cet événement historique emprunte souvent au registre comique, lorsque les acteurs s'habillent de costumes occidentaux d'époque et se coiffent d'un haut-de-forme pour imiter des missionnaires britanniques un peu égarés face à des populations dont ils ne maîtrisaient pas encore la langue et les usages.
Dans la plupart des îles polynésiennes, l'arrivée des premiers missionnaires (généralement protestants) est commémorée chaque année par des rassemblements où l'on chante, danse et rejoue la scène inaugurale, celle de la rencontre entre d'un côté les missionnaires européens ou les "teachers" - notamment ceux des îles de la Société ,qui les ont secondés dès le début du 19ème siècle - et de l'autre, les populations locales. Ainsi, en Polynésie française, le 5 mars - férié - est officiellement jour de "l'arrivée de l'Évangile", en souvenir de l'arrivée à Tahiti en 1797 du voilier le Duff afrêté par la London Missionary Society. À cette date tahitienne, plusieurs îles ont ajouté des cérémonies rappelant le jour où le christianisme est parvenu jusqu'à elles. La mise en scène de cet événement historique emprunte souvent au registre comique, lorsque les acteurs s'habillent de costumes occidentaux d'époque et se coiffent d'un haut-de-forme pour imiter des missionnaires britanniques un peu égarés face à des populations dont ils ne maîtrisaient pas encore la langue et les usages. Mais c'est sans doute aux îles Cook, un micro-État polynésien (en libre association avec la Nouvelle-Zélande) situé à l'ouest de la Polynésie française, que le spectacle est le plus haut en couleurs. Ici aussi, chaque île a longtemps célébré son propre jour anniversaire, par exemple le 25 juillet sur l'île principale, Rarotonga. Mais sur cette île, la plus grande célébration a désormais lieu le 26 octobre, en souvenir de l'arrivée des missionnaires menés par le Rev. John Williams
Mais c'est sans doute aux îles Cook, un micro-État polynésien (en libre association avec la Nouvelle-Zélande) situé à l'ouest de la Polynésie française, que le spectacle est le plus haut en couleurs. Ici aussi, chaque île a longtemps célébré son propre jour anniversaire, par exemple le 25 juillet sur l'île principale, Rarotonga. Mais sur cette île, la plus grande célébration a désormais lieu le 26 octobre, en souvenir de l'arrivée des missionnaires menés par le Rev. John Williams  sur l'île d'Aitutaki, le 26 octobre 1821. C'est un jour de fête nationale: le "National Gospel Day". C'est l'occasion pour les six paroisses de la Cook Islands Christian Church (l'église protestante issue de cette histoire missionnaire) de Rarotonga de préparer des représentations - nuku en langue locale - qui non seulement reconstituent la scène du 26 octobre 1821 mais mettent aussi en scène des événements marquants de l'histoire récente: en 2007, les spectateurs ont par exemple pu voir une reconstitution du détournement d'avion sur le World Trade Center ! Jusque dans les années 1990, il s'agissait d'un concours. Aujourd'hui, même si cette logique de compétition a été abandonné, ces nuku donnent encore lieu à un véritable concours d'imagination. Le site
sur l'île d'Aitutaki, le 26 octobre 1821. C'est un jour de fête nationale: le "National Gospel Day". C'est l'occasion pour les six paroisses de la Cook Islands Christian Church (l'église protestante issue de cette histoire missionnaire) de Rarotonga de préparer des représentations - nuku en langue locale - qui non seulement reconstituent la scène du 26 octobre 1821 mais mettent aussi en scène des événements marquants de l'histoire récente: en 2007, les spectateurs ont par exemple pu voir une reconstitution du détournement d'avion sur le World Trade Center ! Jusque dans les années 1990, il s'agissait d'un concours. Aujourd'hui, même si cette logique de compétition a été abandonné, ces nuku donnent encore lieu à un véritable concours d'imagination. Le site  Dimanche 7 octobre,
Dimanche 7 octobre,  gouvernement de la Nouvelle-Zélande aux lois de Dieu, Brian Tamaki est aujourd’hui devenu l’homme que beaucoup de Néo-zélandais adorent détester. Dans une société largement sécularisée, il symbolise un christianisme minoritaire mais très militant, attaché aux valeurs familiales et hostile à la construction d’un pluralisme religieux apaisé entre la multitude de religions présentes dans ce pays d’immigration. Ces réseaux militants ont eu au cours des dernières années plusieurs occasion de se manifester : controverse autour de l’éventuelle suppression de la traditionnelle prière d’ouverture au Parlement (finalement maintenue), loi «anti-smacking», contre les châtiments corporels sur les enfants – qui a suscité une pétition des milieux évangéliques – ou encore, quelques années auparavant, les lois instaurant une union civile.
gouvernement de la Nouvelle-Zélande aux lois de Dieu, Brian Tamaki est aujourd’hui devenu l’homme que beaucoup de Néo-zélandais adorent détester. Dans une société largement sécularisée, il symbolise un christianisme minoritaire mais très militant, attaché aux valeurs familiales et hostile à la construction d’un pluralisme religieux apaisé entre la multitude de religions présentes dans ce pays d’immigration. Ces réseaux militants ont eu au cours des dernières années plusieurs occasion de se manifester : controverse autour de l’éventuelle suppression de la traditionnelle prière d’ouverture au Parlement (finalement maintenue), loi «anti-smacking», contre les châtiments corporels sur les enfants – qui a suscité une pétition des milieux évangéliques – ou encore, quelques années auparavant, les lois instaurant une union civile. Dimanche 7 octobre toujours, 16 heures, à Takapuna au nord d’Auckland. La
Dimanche 7 octobre toujours, 16 heures, à Takapuna au nord d’Auckland. La