 Je vous avais parlé dans une note de juin 2006 d'un colloque franco-québecois organisé à l'école des hautes études en sciences sociales sur le thème de l'autochtonie, colloque au cours duquel j'avais présenté une communication intitulée "Youth With a Mission et les cultures polynésiennes: définition et mise en scène des identités autochtones en protestantisme évangélique". Les actes de ce colloque viennent de paraître aux Presses universitaires de Laval (Québec) et seront prochainement disponibles en France. Plusieurs spécialistes des îles du Pacifique y ont participé.
Je vous avais parlé dans une note de juin 2006 d'un colloque franco-québecois organisé à l'école des hautes études en sciences sociales sur le thème de l'autochtonie, colloque au cours duquel j'avais présenté une communication intitulée "Youth With a Mission et les cultures polynésiennes: définition et mise en scène des identités autochtones en protestantisme évangélique". Les actes de ce colloque viennent de paraître aux Presses universitaires de Laval (Québec) et seront prochainement disponibles en France. Plusieurs spécialistes des îles du Pacifique y ont participé.
Alban Bensa, anthropologue de la Nouvelle-Calédonie, et Jonathan Friedman, qui s'intéresse à l'anthropologie des systèmes mondiaux et a notamment étudié les mobilisations autochtones à Hawaii, ont contribué à la première section du livre, qui porte sur les généalogies du concept d'autochtonie. A. Bensa revient sur la complexité des relations entre territoire, "gens d'ici" et "gens d'ailleurs", en comparant le modèle de l'étranger-roi (où la légitimité et l'exercice du pouvoir supposent que l'on soit, au moins symboliquement, étranger à la société concernée) à d'autres modèles inverses, comme les sociétés mélanésiennes  dominées par la figure du Big Man, qui s'impose parmi les siens en tissant des réseaux de parenté et de solidarité. Il souligne ainsi la nécessité de replacer le concept d'autochtonie dans les différents contextes politiques où il est utilisé. J. Friedman examine lui aussi les variations contemporaines de "l'indigénéité" (terme équivalent à autochtonie, proche du terme anglophone Indigenous) en lien avec les Etats nationaux et insiste sur l'idée que "l'indigénéité ne fait pas référence à un type particulier de société ni même de mode de vie, mais à une identité politique", qui se construit dans un rapport avec l'Etat.
dominées par la figure du Big Man, qui s'impose parmi les siens en tissant des réseaux de parenté et de solidarité. Il souligne ainsi la nécessité de replacer le concept d'autochtonie dans les différents contextes politiques où il est utilisé. J. Friedman examine lui aussi les variations contemporaines de "l'indigénéité" (terme équivalent à autochtonie, proche du terme anglophone Indigenous) en lien avec les Etats nationaux et insiste sur l'idée que "l'indigénéité ne fait pas référence à un type particulier de société ni même de mode de vie, mais à une identité politique", qui se construit dans un rapport avec l'Etat.
 C'est justement le thème de la seconde section du livre ("Les autochtones et l'Etat"), où trois textes concernent plus ou moins directement l'Océanie, en particulier la Nouvelle-Calédonie. L'historienne Isabelle Merle, spécialiste de la colonisation, montre les ambiguïtés du "statut personnel" mis en place par l'Etat français dans ses colonies, avec la création d'une catégorie juridique, les "sujets d'Empire", fondée sur une distinction entre nationalité et citoyenneté: ils étaient Français non citoyens, un entre-deux qui - écrit-elle - permettait "à la fois de tolérer des pratiques indigènes non conformes aux normes du Code civil et d'ouvrir des possibilités légales de répression impossibles en France métropolitaine". Un second article, de Régis Laffargue, revient sur les relations entre république, coutume et droit dans l'outre-mer français, qui ne sont pas sans rappeler la manière dont la laïcité a été "aménagée" outre-mer pour
C'est justement le thème de la seconde section du livre ("Les autochtones et l'Etat"), où trois textes concernent plus ou moins directement l'Océanie, en particulier la Nouvelle-Calédonie. L'historienne Isabelle Merle, spécialiste de la colonisation, montre les ambiguïtés du "statut personnel" mis en place par l'Etat français dans ses colonies, avec la création d'une catégorie juridique, les "sujets d'Empire", fondée sur une distinction entre nationalité et citoyenneté: ils étaient Français non citoyens, un entre-deux qui - écrit-elle - permettait "à la fois de tolérer des pratiques indigènes non conformes aux normes du Code civil et d'ouvrir des possibilités légales de répression impossibles en France métropolitaine". Un second article, de Régis Laffargue, revient sur les relations entre république, coutume et droit dans l'outre-mer français, qui ne sont pas sans rappeler la manière dont la laïcité a été "aménagée" outre-mer pour 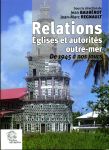 tenir compte de traditions locales englobant parfois le christianisme. La loi statutaire faisant de Wallis et Futuna un territoire d'outre-mer, en 1961, reconnaissait par exemple implicitement le catholicisme comme un élément de "tradition locale" à préserver, quand elle prévoyait que "la République garantit aux populations du Territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi". C'est un sujet dont j'avais parlé ici à propos d'un autre livre, coordonné par Jean Baubérot et Jean-Marc Regnault, sur les relations autorités-églises outre-mer. Enfin, Marcel Djama analyse en détails les politiques de l'autochtonie en Nouvelle-Calédonie, depuis l'établissement de frontières sociales et raciales par l'Etat français (entre les différentes catégories d'indigènes et d'immigrants, dont certains étaient eux-mêmes colonisés, comme les travailleurs indochinois) jusqu'à ce qu'il appelle une "ethnicisation du champ politique", avec l'émergence de la revendication indépendantiste kanak au cours des années 1970.
tenir compte de traditions locales englobant parfois le christianisme. La loi statutaire faisant de Wallis et Futuna un territoire d'outre-mer, en 1961, reconnaissait par exemple implicitement le catholicisme comme un élément de "tradition locale" à préserver, quand elle prévoyait que "la République garantit aux populations du Territoire des îles Wallis et Futuna le libre exercice de leur religion, ainsi que le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions de la présente loi". C'est un sujet dont j'avais parlé ici à propos d'un autre livre, coordonné par Jean Baubérot et Jean-Marc Regnault, sur les relations autorités-églises outre-mer. Enfin, Marcel Djama analyse en détails les politiques de l'autochtonie en Nouvelle-Calédonie, depuis l'établissement de frontières sociales et raciales par l'Etat français (entre les différentes catégories d'indigènes et d'immigrants, dont certains étaient eux-mêmes colonisés, comme les travailleurs indochinois) jusqu'à ce qu'il appelle une "ethnicisation du champ politique", avec l'émergence de la revendication indépendantiste kanak au cours des années 1970.
 Une quatrième section du livre est plus spécifiquement consacrée aux "revendications de soi comme autochtones dans le Pacifique". C'est dans cette section qu'est publié mon article sur Youth With a Mission. Associer évangéliques et autochtonie peut paraître hors sujet, les missionnaires évangéliques étant généralement considérés - non sans raison - comme des agents d'acculturation et de déstabilisation des sociétés traditionnelles. Mais un ensemble d'évolutions repérables depuis les années 1980 au sein du protestantisme charismatique a contribué à l'essor de mouvements qui se revendiquent désormais "autochtones chrétiens" et mettent en avant des expressions culturelles comme les danses, exclues des cérémonies religieuses dans la plupart des églises protestantes historiques d'Océanie. Youth With a Mission, une organisation évangélique charismatique fondée en 1960 en Californie, aujourd'hui présente dans près de 170 pays, a joué un rôle central dans cette évolution, en particulier au travers du programme Island Breeze lancé en 1979 par le Samoan Sosene Le'au, qui prône l'utilisation des danses autochtones comme expression de la foi chrétienne et instrument d'évangélisation.
Une quatrième section du livre est plus spécifiquement consacrée aux "revendications de soi comme autochtones dans le Pacifique". C'est dans cette section qu'est publié mon article sur Youth With a Mission. Associer évangéliques et autochtonie peut paraître hors sujet, les missionnaires évangéliques étant généralement considérés - non sans raison - comme des agents d'acculturation et de déstabilisation des sociétés traditionnelles. Mais un ensemble d'évolutions repérables depuis les années 1980 au sein du protestantisme charismatique a contribué à l'essor de mouvements qui se revendiquent désormais "autochtones chrétiens" et mettent en avant des expressions culturelles comme les danses, exclues des cérémonies religieuses dans la plupart des églises protestantes historiques d'Océanie. Youth With a Mission, une organisation évangélique charismatique fondée en 1960 en Californie, aujourd'hui présente dans près de 170 pays, a joué un rôle central dans cette évolution, en particulier au travers du programme Island Breeze lancé en 1979 par le Samoan Sosene Le'au, qui prône l'utilisation des danses autochtones comme expression de la foi chrétienne et instrument d'évangélisation.
L'anthropologue canadienne Sylvie Poirier présente dans la même section une analyse comparée des stratégies de résistance et de revendications identitaires de deux groupes autochtones, l'un au Canada (la nation amérindienne Atikamekws, dans le centre-nord du Québec) et l'autre en Australie (les Kukatjas du désert occidental). Vahi Sylvia Tuheiava-Richaud (ci-contre), maîtresse de conférences  à l'université de la Polynésie française, spécialiste du reo ma'ohi (les langues polynésiennes) reprend ensuite la généalogie des termes tahitiens définissant une identité culturelle autochtone - ma'ohi, nuna'a (le peuple en tant que nation), ta'ata tahiti (personne tahitienne) - qu'elle replace dans le contexte historique où ils se sont progressivement imposés. Pierre-Yves Le Meur propose une comparaison concernant l'intégration et la production sociale des étrangers en Afrique de l'Ouest et en Océanie. Viviane Cretton souligne l'ambivalence de la référence à
à l'université de la Polynésie française, spécialiste du reo ma'ohi (les langues polynésiennes) reprend ensuite la généalogie des termes tahitiens définissant une identité culturelle autochtone - ma'ohi, nuna'a (le peuple en tant que nation), ta'ata tahiti (personne tahitienne) - qu'elle replace dans le contexte historique où ils se sont progressivement imposés. Pierre-Yves Le Meur propose une comparaison concernant l'intégration et la production sociale des étrangers en Afrique de l'Ouest et en Océanie. Viviane Cretton souligne l'ambivalence de la référence à l'autochtonie dans les discours sur la nation fidjienne (un thème évoqué ici dans une note de décembre 2006), dans un article qui, de façon un peu surprenante, laisse de côté la dimension religieuse de la notion de "réconciliation" à Fidji et le rôle des églises dans les tensions entre autochtones et Indo-Fidjiens. Les églises chrétiennes y jouent en effet un rôle décisif, comme l'a montré l'anthropologue danoise Jacqueline Ryle: l'église méthodiste fidjienne est devenue un des fers de lance des revendications en faveur d'un pouvoir autochtone chrétien (qui excluerait de facto les Indo-Fidjiens, majoritairement hindous et musulmans), tandis que la plupart des églises pentecôtistes n'envisagent une réconciliation nationale qu'au prix de la conversion des Indo-Fidjiens et que l'église catholique prône quant à elle le dialogue et la tolérance entre communautés.
l'autochtonie dans les discours sur la nation fidjienne (un thème évoqué ici dans une note de décembre 2006), dans un article qui, de façon un peu surprenante, laisse de côté la dimension religieuse de la notion de "réconciliation" à Fidji et le rôle des églises dans les tensions entre autochtones et Indo-Fidjiens. Les églises chrétiennes y jouent en effet un rôle décisif, comme l'a montré l'anthropologue danoise Jacqueline Ryle: l'église méthodiste fidjienne est devenue un des fers de lance des revendications en faveur d'un pouvoir autochtone chrétien (qui excluerait de facto les Indo-Fidjiens, majoritairement hindous et musulmans), tandis que la plupart des églises pentecôtistes n'envisagent une réconciliation nationale qu'au prix de la conversion des Indo-Fidjiens et que l'église catholique prône quant à elle le dialogue et la tolérance entre communautés.
 Bref, il s'agit d'une somme considérable d'analyses et de connaissances (530 pages) qui constitue une étape importante dans le développement des études francophones sur le concept d'autochtonie et les revendications en faveur des peuples autochtones, qui ont été notamment reconnues dans le cadre de l'ONU. L'assemblée générale des nations unies a ainsi adopté en septembre 2007, à une large majorité, une déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones. Quatre pays ont voté contre, dont deux sont en Océanie: l'Australie et la Nouvelle-Zélande (les deux autres étant le Canada et les Etats-Unis). Ils entendaient ainsi contester tout droit à l'autodétermination politique des peuples autochtones, maori en Nouvelle-Zélande et aborigènes en Australie.
Bref, il s'agit d'une somme considérable d'analyses et de connaissances (530 pages) qui constitue une étape importante dans le développement des études francophones sur le concept d'autochtonie et les revendications en faveur des peuples autochtones, qui ont été notamment reconnues dans le cadre de l'ONU. L'assemblée générale des nations unies a ainsi adopté en septembre 2007, à une large majorité, une déclaration des nations unies sur les droits des peuples autochtones. Quatre pays ont voté contre, dont deux sont en Océanie: l'Australie et la Nouvelle-Zélande (les deux autres étant le Canada et les Etats-Unis). Ils entendaient ainsi contester tout droit à l'autodétermination politique des peuples autochtones, maori en Nouvelle-Zélande et aborigènes en Australie.
Illustrations: Big man en Papouasie Nouvelle-Guinée sur daylife.com ; case d'un chef kanak sur le site d'A. Videt ; danseurs d'Island Breeze ; Vahi Sylvia Tuheiava Richaud ; église méthodiste à Fidji sur le site du COE ; logo du forum permanent sur les questions autochtones (UNPFII).
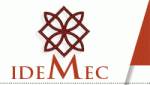 Du 26 au 28 novembre 2008 a eu lieu à la Maison méditéranéenne des sciences de l'homme (MMSH), à l'invitation de l'anthropologue Christophe Pons et avec le soutien du CNRS, de l'Université de Provence et de l'
Du 26 au 28 novembre 2008 a eu lieu à la Maison méditéranéenne des sciences de l'homme (MMSH), à l'invitation de l'anthropologue Christophe Pons et avec le soutien du CNRS, de l'Université de Provence et de l' La question des relations entre christianisme(s) et culture(s) dans les îles du Pacifique est à la fois un thème classique de l'anthropologie et un point sensible qui suscite réflexions, débats et controverses. Elle touche en effet implicitement à la définition de la culture, voire de l'authenticité culturelle, à partir de laquelle les anthropologues abordent ces sociétés. Décrire le christianisme contemporain en Océanie, surtout les églises les plus récentes où l'articulation entre culture locale et foi chrétienne n'est souvent pas évidente de prime abord, c'est toujours prendre le risque d'apparaître comme quelqu'un qui choisit délibéremment d'ignorer la spécificité culturelle locale en se concentrant sur une sorte de religieux "hors sol". Le pentecôtisme est-il une religion totalement étrangère à la culture polynésienne? Peut-on identifier dans les pratiques des pentecôtistes polynésiens des correspondances avec une culture pré-chrétienne ou avec ce qu'on appelle aujourd'hui la "tradition chrétienne" (incarnée par les églises historiques, comme l'église protestante ma'ohi)? La conversion au pentecôtisme traduit-elle une occidentalisation, une forme d'acculturation, liée par exemple à l'urbanisation et à l'individualisation des modes de vie ? Ou le pentecôtisme participe-t-il aussi aux recompositions contemporaines de l'identité culturelle polynésienne?
La question des relations entre christianisme(s) et culture(s) dans les îles du Pacifique est à la fois un thème classique de l'anthropologie et un point sensible qui suscite réflexions, débats et controverses. Elle touche en effet implicitement à la définition de la culture, voire de l'authenticité culturelle, à partir de laquelle les anthropologues abordent ces sociétés. Décrire le christianisme contemporain en Océanie, surtout les églises les plus récentes où l'articulation entre culture locale et foi chrétienne n'est souvent pas évidente de prime abord, c'est toujours prendre le risque d'apparaître comme quelqu'un qui choisit délibéremment d'ignorer la spécificité culturelle locale en se concentrant sur une sorte de religieux "hors sol". Le pentecôtisme est-il une religion totalement étrangère à la culture polynésienne? Peut-on identifier dans les pratiques des pentecôtistes polynésiens des correspondances avec une culture pré-chrétienne ou avec ce qu'on appelle aujourd'hui la "tradition chrétienne" (incarnée par les églises historiques, comme l'église protestante ma'ohi)? La conversion au pentecôtisme traduit-elle une occidentalisation, une forme d'acculturation, liée par exemple à l'urbanisation et à l'individualisation des modes de vie ? Ou le pentecôtisme participe-t-il aussi aux recompositions contemporaines de l'identité culturelle polynésienne?